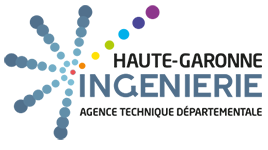Les dispositions relatives à l’urbanisation de la loi relative a la liberté de création, a l’architecture et au patrimoine
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine dite loi « LCAP » a apporté son lot d’évolutions en matière d’urbanisme qui peuvent avoir des conséquences pour les communes ou les intercommunalités compétentes en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et Carte Communale, notamment en réformant les codes de l’urbanisme et du patrimoine.
En préambule, il convient de noter que l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, qui définit la notion de développement durable en matière d’urbanisme et son étendue, a été une nouvelle fois modifié. Ainsi, au d) du paragraphe 1, la phrase « la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable » devient : « la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel », étendant fortement la notion de patrimoine à protéger.
Les changements introduits par la loi portent, dans le domaine de l’urbanisme, en particulier sur les quatre champs d’intervention développés ci-après.
Améliorer la qualité architecturale des constructions
A ce titre :
- le seuil de recours obligatoire à un architecte pour une construction édifiée ou modifiée par une personne physique est abaissé à 150 m² de surface de plancher (au lieu de 170 m²). Cette mesure, qui a été précisée par le décret n° 2016-1937 du 14 décembre 2016, est applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017 ;
- dans le cas des lotissements soumis à permis d’aménager, la demande d’autorisation ne peut être instruite que si le projet architectural, paysager et environnemental a été réalisé par des personnes disposant de compétences en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage.
Notamment, la présence d’un architecte sera rendue obligatoire à partir d’un seuil de surface de terrain à aménager. La mise en application de cette nouveauté est soumise à la publication d’un décret à venir, qui en précisera les modalités d’application et la surface minimale au-delà de laquelle le recours à l’architecte sera obligatoire ;
- l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire peut réduire le délai d’instruction de la demande, en principe de 2 mois, si le demandeur a fait établir le projet par un architecte, alors qu’il n’y était pas obligé (construction d’une surface inférieure à 150 m² de surface de plancher) ;
- le nom de l’architecte auteur du projet architectural doit être affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme et apposé, avec la date d’achèvement de l’ouvrage, sur une des façades extérieures de la construction ;
- les communes ont la possibilité, soit dans le règlement du PLU, soit par délibérations motivées, d’accorder des dérogations pour augmenter les droits à construire, en modifiant les règles relatives au gabarit, l’emprise au sol, ou la hauteur, notamment pour les constructions à usage d’habitation en zone urbaine des PLU, les logements locatifs sociaux, les logements intermédiaires ou les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale. Ces dérogations peuvent être majorées dans la limite de 5 % supplémentaires, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, pour des constructions présentant un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturale.
Redéfinir le périmètre de protection des abords des monuments historiques
La protection au titre des abords des monuments historiques s’applique à toute autorisation de travaux concernant un immeuble bâti ou non bâti, visible depuis le monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cent mètres (500) de celui-ci.
Toutefois, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), l’autorité administrative peut délimiter un périmètre de protection des abords différent, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de PLU. A l’intérieur de ce périmètre l’obligation d’autorisation pour les travaux s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti.
A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de PLU (commune ou EPCI), la décision de délimitation du nouveau périmètre est prise :
- par l’autorité administrative (Préfet), après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le nouveau périmètre ne dépasse pas celui de 500 mètres ;
- par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le nouveau périmètre dépasse la distance de 500 mètres par rapport au monument historique.
L’enquête publique est menée concomitamment à celle concernant l’élaboration, la révision ou la modification d’un PLU ou d’une carte communale, lorsque les deux procédures sont réalisées en même temps.
Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords, sont soumis à une autorisation préalable.
Les sites patrimoniaux remarquables (SPR)
La loi « LCAP » prévoit le regroupement de toutes les protections du patrimoine, bâti ou non bâti, secteur sauvegardé, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), mais également site classé pour les milieux naturels et agricoles, en un seul type de protection dénommée « site patrimonial remarquable » (SPR). L’article nouveau L.631-1 du code du patrimoine définit le champ d’application du SPR :
« Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne. »
Les SPR sont classés par décision du Ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, de l’autorité compétente en matière de PLU et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées et enquête publique.
Les commissions nationales et régionales du patrimoine et de l’architecture et les communes intégralement ou partiellement concernées par le site patrimonial remarquable peuvent être à l’origine de la demande de classement.
Les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP crées avant la publication de la loi « LCAP » (soit avant le 8 juillet 2016) deviennent de plein droit des SPR à cette date.
De même, les AVAP mises à l’étude avant la publication de la loi deviennent de plein droit des SPR le jour de leur création et leur règlement est applicable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
La traduction de la protection apportée au patrimoine bâti ou non bâti pour le SPR peut se décliner selon deux documents :
- le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui permet de soumettre à déclaration préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris le second œuvre, ou des immeubles non bâtis, mais également les éléments d’architecture et de décoration, même intérieurs à la construction, lorsqu’ils sont protégés par le PSMV ;
- le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine qui ne concerne que les travaux sur les extérieurs des immeubles bâtis ou non bâtis.
Les demandes d’autorisation sont soumises à avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), en cas de silence de celui-ci dans le délai de deux mois de consultation, son avis est réputé favorable.
En cas de désaccord avec l’avis de l’ABF, le dossier d’autorisation est transmis au Préfet, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ; le silence du Préfet équivaut au rejet de la décision.
Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP)
Ce document, qui remplace les ZPPAUP et AVAP, est élaboré, révisé ou modifié par l’autorité compétente en matière de PLU (commune ou EPCI) en concertation avec l’ABF.
L’Etat apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour la réalisation des études.
Les procédures :
L’autorité compétente est la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU, ce dernier peut déléguer sa compétence à la ou aux communes concernées par le PVAP qui en font la demande par délibération de leur conseil municipal.
- Même si le code du patrimoine ne le demande pas, il semble préférable de prévoir une délibération de l’organe délibérant de l’autorité compétente au titre du code général des collectivités territoriales, pour prescrire la procédure.
- Le projet de PVAP est arrêté par délibération de l’autorité compétente après avis de la ou des communes concernées, le cas échéant. En cas de désaccord, l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture est sollicité.
- Le projet arrêté est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Il fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques suivantes : Etat, Région, Département, Etablissement public en charge du SCOT, Chambres d’Agriculture, de Commerce, des Métiers, EPCI compétent en programme local de l’habitat, autorité organisatrice des transports collectifs, organismes de gestion des parcs naturels régionaux.
De plus, le projet de PVAP est soumis pour avis à la commission locale du SPR, composée de représentants de l’Etat, de la ou des communes concernées, d’associations de protection, de promotion ou de mise en valeur du patrimoine et de personnes qualifiées ;
- Le projet arrêté de PVAP est soumis à enquête publique ;
( Le PVAP est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en PLU, après accord de l’autorité administrative (Préfet). Il est annexé, le cas échéant, au PLU en tant que servitude d’utilité publique.
Cette procédure s’applique aux élaboration et révision des PVAP.
Ce document peut également faire l’objet d’une procédure de modification, plus simple, approuvée après enquête publique, lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification du PVAP emporte, le cas échéant, modification du PLU.
Les procédures de PVAP peuvent être menées de manière conjointe avec celles correspondantes du PLU et font l’objet, dans ce cas, d’une enquête publique unique.
Le contenu du PVAP :
Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine bâti comprend :
- Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic ;
- Un règlement comprenant :
- des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions ;
- des règles relatives à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
- la délimitation des éléments bâtis ou non bâtis à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier ;
- un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.