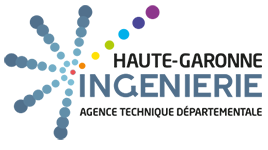Prévention de la délinquance
(Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007)
(Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007)
L'intégralité de ce texte est disponible sur le site Légifrance
La loi relative à la prévention de la délinquance est enfin parue au Journal officiel, mettant ainsi fin à une longue période de réflexion, et à sept mois de procédure parlementaire.
Très attendue par les élus locaux, elle consacre un certain nombre de mesures intéressant directement les collectivités territoriales, et en particulier les communes puisque les maires, « au plus près des réalités du terrain », se voient ainsi confier « un rôle essentiel pour animer et coordonner la politique de prévention de la délinquance » (communiqué du Sénat du 6 septembre 2006).
Chapitre Ier – dispositions générales
Ce premier chapitre précise les compétences de chacun des acteurs de la politique de prévention
Animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance par le maire (article 1er)
L'article 1er-1° affirme le rôle privilégié du maire en matière de prévention de la délinquance en lui confiant le rôle de coordinateur et d'animateur de cette politique sur le territoire de sa commune. Il donne donc une légitimité incontestable à son intervention dans ce domaine: son rôle est central, sans qu'il ne se substitue en aucune manière aux autorités régaliennes chargées de la sécurité intérieure et de la justice (article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT).
Le 2° de cet article améliore l'information du maire en cas de survenance d'infractions d'une certaine gravité sur le territoire de sa commune. En effet, l'article L.2211-3 du CGCT dispose à présent que « les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune ».
L'article L.2211-3 précité prévoit également que le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires (classement sans suite, mesures alternatives aux poursuites ou poursuites). De la même manière, le procureur de la République avise le maire, à sa demande, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés, lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui à ce magistrat.
Le 3° de cet article, qui insère un nouvel article L.2211-4 dans le CGCT, compte parmi les dispositions les plus importantes puisqu'il dispose que « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre ».
Par ailleurs, il rend obligatoire dans les communes de plus de 10.000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine sensible les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) présidés par le maire ou un représentant ayant reçu délégation.
A noter que la création d'un CLSPD est facultative dans les communes membres d'un établissement de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de prévention de la délinquance et doté d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Enfin, un nouvel article L.2211-5 autorise la constitution au sein des CLSPD de groupes de travail et de partage d'informations à vocation territoriale ou thématique, dont les membres sont autorisés à échanger des informations à caractère confidentiel. Les informations ainsi échangées ne peuvent toutefois être communiquées à des tiers. A noter que cette faculté est étendue au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (cf. infra 8°).
Le 5° précise que le préfet associe également le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Une convention définissant les modalités de cette association et de cette information peut à ce titre être signée entre l'Etat et le maire (article L.2215-2 du CGCT).
A noter que les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, doivent être compatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet.
Le 7° de cet article aménage les relations entre le département et les communes en matière de prévention de la délinquance (article L.3214-1 du CGCT). Il prévoit ainsi:
- d'une part, que « les actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance » sont une des composantes des actions sanitaires et sociales relevant de la compétence du conseil général ;
- d'autre part, que pour la mise en œuvre de ces actions de prévention de la délinquance, le département doit conclure avec la commune ou l'EPCI intéressé une convention déterminant les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination ainsi que l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions de prévention de la délinquance mises en œuvre.
Cela signifie que si un département souhaite mener des actions de prévention de la délinquance sur le territoire d'une commune, il sera obligé de se coordonner avec celle-ci.
A noter toutefois que la signature de cette convention n'est obligatoire qu'avec les communes et les EPCI obligatoirement dotés d'un CLSPD ou d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (à savoir communes de plus de 10.000 habitants, celles comprenant une ZUS et EPCI à fiscalité propre exerçant la compétence relative à la prévention de la délinquance).
Le 8° de cet article (nouveaux articles L.5211-59 et L.5211-60 du CGCT) est relatif à l'intercommunalité. Il prévoit que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention, son président anime et coordonne, sous réserve des pouvoirs de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence.
Sauf opposition, le président ou un vice-président désigné de l'établissement préside le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), ce dernier étant obligatoire.
Enfin, lorsqu'il existe, l'EPCI compétent en matière de prévention de la délinquance peut décider d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance, et mettre à disposition de la (ou des) commune(s) intéressée(s), du personnel pour visionner les images. Il convient de souligner que pour la mise en place de ce dispositif, l'EPCI doit au préalable requérir l'accord de la commune d'implantation
Présence de travailleurs sociaux dans les commissariats et les groupements de gendarmerie (article 2)
Cet article consacre la présence de travailleurs sociaux dans les commissariats de police nationale et les brigades de gendarmerie en renvoyant à une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune qui fixe les modalités d'intervention de ces travailleurs sociaux (article L.121-1-1 du code de l'action sociale et des familles – CASF).
Toutefois, il ne rend pas obligatoire la présence d'un travailleur social dans chaque commissariat, ce choix étant renvoyé au niveau local.
Délégation de compétences du département aux communes en matière d'action sociale (article 3)
Cet article vient, d'une part, accroître les compétences du département en matière de prévention de la délinquance et, d'autre part, assouplir les conditions dans lesquelles le département peut déléguer à une commune tout ou partie de ses compétences en matière d'action sociale.
L'article L.121-6 du CASF offre déjà aux départements la possibilité de déléguer aux communes les compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, leur sont attribuées en vertu de l'article L.121-1 du CASF. Cette faculté a néanmoins été très peu utilisée, notamment en raison du fait que la loi n'autoriserait qu'une délégation en bloc de l'action sociale et non des délégations partielles.
C'est la raison pour laquelle le 2° du présent article réécrit l'article L.121-6 du CASF afin d'autoriser des délégations partielles de compétence.
Par souci de cohérence, la rédaction des articles L.5215-20-III et L.5216-5-V du CGCT est calquée sur celle de l'article L.121-6. Ce qui peut être délégué aux communes doit pouvoir l'être dans les mêmes conditions aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération compétentes en matière d'action sociale, mais à présent également aux communautés de communes ayant choisi d'exercer la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire.
Recrutement d'agents de police municipale communs à plusieurs communes (article 4)
L'objectif est de permettre à des municipalités moyennes ou petites de mutualiser le coût d'une police municipale en leur donnant la possibilité de disposer d'agents de police municipale en commun.
L'article L.2212-5 du CGCT autorise déjà les EPCI à recruter un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble des communes de l'EPCI. Cette décision est prise après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Désormais, les communes limitrophes de moins de 20.000 habitants et regroupant au total moins de 50.000 habitants pourront utiliser en commun un ou plusieurs agents de police municipale, compétents sur le territoire de chacune de ces communes (nouvel article L.2212-10 du CGCT).
Pendant l'exercice de leurs missions sur le territoire d'une commune, les agents restent sous l'autorité du maire de cette commune.
Légalement, les agents ne seront employés que par une seule des communes. Il ne s'agira pas à proprement parler d'agents de police municipale intercommunaux. Une convention, transmise par le préfet et conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précisera les modalités d'organisation et de financement.
Par ailleurs, ces communes seront obligées de se doter d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'Etat. Le droit commun (article L.2212-6 du CGCT) ne la rend toutefois obligatoire qu'à partir d'un seuil de cinq agents de police municipale.
Concernant le port d'arme, ce texte reprend le mécanisme d'ores et déjà applicable aux agents de police municipale intercommunaux (à savoir le port d'arme demandé pour des agents de police municipale intercommunaux doit être demandé par chaque maire, mais le préfet examine la demande sur un plan intercommunal afin de délivrer des autorisations identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne l'autorisation d'acquisition et de détention des armes, le préfet recommande qu'à la différence des autorisations de port d'arme, la demande soit présentée par une seule commune. Cette commune doit conserver les armes dans un coffre-fort ou une armoire forte situés dans une pièce sécurisée de son poste de police municipale et doit tenir un registre d'inventaire). Il prévoit ainsi que la demande de port d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ces communes devront désigner parmi elles celle qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes.
Enfin, afin d'éviter des superpositions de régimes différents d'agents de police municipale, cette loi prévoit que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents dans les conditions sus-évoquées lorsque l'EPCI recrute déjà des agents de police municipale intercommunaux.
Création d'un Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (article 5)
Il est créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance, et dont l'utilisation des crédits est coordonnée par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Participation des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs à la prévention de la délinquance (article 6)
Cet article crée, à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, une obligation de concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers mais également des personnels.
Chapitre II – dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative
Ce chapitre vise à remédier aux dysfonctionnements des institutions qui résultent avant tout d'un manque de cohérence et d'anticipation. La mise en réseau des acteurs du champ social et médico-social, ainsi que des professionnels de l'enseignement ne peut que concourir à la réduction de facteurs favorisant la marginalisation ou la déscolarisation.
Partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire (article 8)
Cet article insère dans le CASF un article L.121-6-2 qui définit le cadre dans lequel les professionnels de l'action sociale, soumis au secret professionnel, pourront partager entre eux des informations confidentielles. Il détermine également les conditions de la transmission éventuelle de ces informations au maire et au président du conseil général aux fins d'actions dans les domaines sanitaire, éducatif et social.
Le premier alinéa l'article L.121-6-2 délie les professionnels de l'action sociale de leur obligation de confidentialité envers le maire et le président du conseil général, lorsqu'il apparaît à l'un de ces professionnels que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle précisément l'intervention de plusieurs professionnels de l'action sociale. Dans ce cas, le professionnel en informe le maire et le président du conseil général.
Les deuxième et troisième alinéas sont, quant à eux, relatifs aux modalités de désignation par le maire, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général, d'un coordonnateur parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille.
A noter que dans l'hypothèse où l'ensemble des professionnels intervenant sur une même personne relèvent du département, le maire désigne le coordonnateur sur proposition du président du conseil général.
Il convient de souligner que la désignation du coordonnateur par le maire intervient uniquement lorsqu'elle lui apparaît nécessaire à l'efficacité et à la continuité de l'action sociale, et non à chaque fois que plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne. En pratique, la désignation d'un coordonnateur par le maire n'apparaît que facultative.
Les quatrième et cinquième alinéas sont relatifs au secret partagé entre les professionnels, y compris le coordonnateur. Ainsi, des professionnels intervenant auprès d'une même personne pourront désormais échanger des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé, et ce, même en l'absence d'un coordonnateur.
A noter toutefois que:
- en cas de nomination d'un coordonnateur, celui-ci devra obligatoirement être co-destinataire des informations ainsi échangées ;
- le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
Le sixième alinéa dispose que le coordonnateur est autorisé à révéler au maire, au président du conseil général ou à leur représentant agissant sur délégation, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences.
Enfin, le septième alinéa indique que s'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil (c'est-à-dire si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises), le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général. Le maire est informé de cette transmission (disposition de coordination avec la loi réformant la protection de l'enfance).
Création du conseil pour les droits et devoirs des familles – Accompagnement parental proposé par le maire (article 9)
Un conseil pour les droits et devoirs des familles (CDDF) est créé par délibération du conseil municipal et présidé par le maire ou son représentant (articles L.141-1 et suivants du CASF).
Il peut comprendre des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance.
Le CDDF a pour mission:
- d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
- d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale.
Ce conseil est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental et il peut, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale.
Par ailleurs, lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. De la même manière, l'accompagnement parental peut être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
Cet accompagnement, dont la mise en place requiert l'avis du président du conseil général, doit être complémentaire avec le contrat de responsabilité parentale ou les mesures d'assistance éducative décidées par le juge.
Saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales (article 10)
Au préalable, il est important de rappeler que la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permet au juge des enfants d'ordonner que les prestations familiales soient versées, en tout ou partie, à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales » lorsqu'il apparaît qu'elles ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale n'est pas suffisant (nouvel article 375-9-1 du code civil).
La présente loi complète ce dispositif en donnant au maire ou à son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles, la possibilité de saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille.
Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L.121-6-2 du CASF (cf. supra article 8 de la loi), il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
Rappel à l'ordre par les maires (article 11)
Cet article autorise le maire, ou un adjoint agissant par délégation, à procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l'endroit de l'auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques (article L.2212-2-1 du CGCT).
Lutte contre l'absentéisme scolaire – Concours de l'éducation nationale à la prévention de la délinquance (article 12)
Le paragraphe 2° de cet article donne la possibilité au maire de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel aux fins de recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et d'amélioration du suivi de l'obligation d'assiduité scolaire (article L.131-6 du code de l'éducation).
Afin d'alimenter ce fichier, il est prévu la transmission au maire de plusieurs informations:
- la liste des enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune (communiquée par les organismes chargés du versement des prestations familiales) ;
- la liste des élèves domiciliés dans la commune qui ont fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire (adressée par les inspecteurs d'académie).
- les décisions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement scolaire ainsi que les cas d'abandon de la scolarité (communiquées par les directeurs d'établissement d'enseignement).
Par ailleurs, le paragraphe 3° prévoit que les directeurs d'établissement d'enseignement informent le maire lorsqu'ils décident de saisir l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement. Cela devrait permettre l'information du maire en aval, avant que l'inspecteur d'académie ne prenne sa décision.
En outre, il est désormais fait obligation au directeur d'un établissement d'enseignement de saisir l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme (article L.131-8 du code de l'éducation).
Enfin, le paragraphe 6° rétablit dans le code de l'éducation les dispositions relatives à l'enseignement scolaire pour les jeunes adultes (article L.214-13). Appelées Ecoles de la deuxième chance, ces établissements proposent une formation à des personnes de dix-huit à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme.
Chapitre III – dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et a prévenir les troubles du voisinage
En vue de responsabiliser chaque citoyen afin de faire en sorte que la prévention de la délinquance soit une préoccupation partagée par tous et que le cadre de la vie quotidienne devienne moins vulnérable ou moins exposé aux faits de délinquance, ce chapitre prévoit des dispositions pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, notamment par des mesures destinées à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage.
Etudes de sécurité publique (article 14 – article L.111-3-1 du code de l'urbanisme)
Les projets d'aménagement et de réalisation des équipements collectifs et les programmes de construction, qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique, afin d'en apprécier les conséquences.
Un décret d'application, dont le contenu est précisément fixé, doit indiquer les modalités d'application de cette disposition.
A noter que lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret susmentionné. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.
Enfin, le maire peut obtenir communication de l'étude de sécurité publique alors même qu'elle constitue un document non communicable.
Sécurisation des parties communes des copropriétés (article 15)
Cet article modifie les conditions de majorité des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires relatives à la réalisation de travaux de sécurité dans les parties communes et aux périodes d'ouverture et de fermeture des halls d'immeubles.
Participation facultative des communes aux dépenses de gardiennage des immeubles (article 16)
L'article L.127-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
La loi complète cette disposition en permettant la participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses liées à l'obligation de gardiennage ou de surveillance d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
Ne sont donc concernés que les immeubles particulièrement exposés à des risques de délinquance et pris en compte spécifiquement par un contrat local de sécurité.
Pouvoirs du maire en matière d'application des règles de sécurité des locaux contenant des matières explosives ou inflammables (article 17)
Le présent article permet l'application effective des règles de sécurité relatives aux locaux contenant des matières explosives ou inflammables et attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Il accentue à ce titre le caractère dissuasif de la mise en demeure par le maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité puisqu'il prévoit désormais une amende de 3.750 €, et non plus 38 € comme précédemment, en cas de non-respect (article L.129-4-1 du code de la construction et de l'habitation – CCH).
Responsabilité du propriétaire en cas de trouble de voisinage du fait de son preneur et rôle du maire (article 18)
Cet article offre au bailleur un moyen nouveau de faire cesser le trouble. L'article 1729 du code civil ainsi que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sont complétés afin de permettre au bailleur de résilier de plein droit le bail en cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Par ailleurs, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, et après mise en demeure dûment motivée, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Enfin, le paragraphe III de cet article précise que le maire au titre de la police municipale est chargé de la répression des « troubles de voisinage », et non pas seulement des « bruits de voisinage », comme l'indiquent actuellement les articles L.2212-2 et L.2214-4 du CGCT.
Obligation pour les propriétaires d'un ensemble commercial de procéder à sa réhabilitation (article 19 – nouvel article L.300-7 du code de l'urbanisme)
Cet article permet aux pouvoirs publics (préfet, le maire après avis du conseil municipal ou président de l'EPCI compétent après avis de son organe délibérant), en zone urbaine sensible, de mettre en demeure les propriétaires d'un ensemble commercial dégradé, vétuste ou non entretenu d'engager une réhabilitation dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine.
A défaut de manifestation de volonté de se conformer à la mise en demeure dans un délai de trois mois, ou lorsque les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de la commune ou de l'EPCI peut être engagée.
Incrimination des attroupements dans les parties communes d'immeubles (article 20)
Tirant les conséquences de trois années d'application du délit d'attroupement dans les parties communes d'immeubles, le paragraphe I de cet article en adapte la définition. Ainsi, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article L.126-3 du CCH, est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté.
A noter que les voies de fait et menaces de toute nature deviennent désormais une circonstance aggravante de l'infraction précitée, portant ainsi la peine à six mois d'emprisonnement et à 7.500 € d'amende.
Répression des conducteurs étrangers pour excès de vitesse – Fonctionnement des fourrières (article 21)
Cet article vise, d'une part, à mieux réprimer les infractions commises par les conducteurs étrangers et, d'autre part, à améliorer le fonctionnement des fourrières.
En premier lieu, cet article prévoit la rétention du véhicule des personnes ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français en cas de non paiement de certaines contraventions.
Par ailleurs, concernant les fourrières, le délai à l'expiration duquel les véhicules laissés en fourrière sont réputés abandonnés, passe de quarante-cinq à trente jours (article L.325-7 du code de la route).
Par ailleurs, les conditions de mise en vente des véhicules réputés abandonnés, sont précisées. Ainsi, l'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai de trente jours en vue de leur mise en vente.
A noter que les véhicules que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont désormais livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.
Enfin, il est indiqué que la propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction (article L.325-8).
Dispositions relatives au permis à points (article 23)
Paragraphes I, II et III – Encadrement des stages de sensibilisation à la sécurité routière
La première mesure porte sur la qualité et l'efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Le code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut les récupérer s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La réalisation d'un stage permet de récupérer quatre points dans la limite du nombre maximal de points affectés au permis. Un délai de deux ans doit s'écouler entre deux stages. Toutefois, lorsque le stage est prononcé à titre de peine complémentaire ou d'alternative aux poursuites pénales, il ne donne pas lieu à récupération de points (articles L.223-6 et R.223-8).
L'article R. 223-5 du code de la route dispose que les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet. Chaque formateur doit avoir été reconnu apte par le préfet (être titulaire d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile ou d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue, avoir suivi une préparation spécifique à l'animation des stages).
Toutefois, ces conditions d'agrément semblent insuffisantes, la qualité des stages étant inégale. C'est la raison pour laquelle les paragraphes I, II et III de cet article prévoient un renforcement des conditions d'agrément des organismes de stages et des formateurs, en les alignant sur celles existant respectivement en matière d'exploitation d'une auto-école et d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Le délai de mise en œuvre du nouveau dispositif prend en compte à la fois la situation des animateurs et des organismes actuellement en exercice et le délai de formation des nouveaux animateurs. Il est donc prévu que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
Paragraphes IV et V – Attribution progressive des points supplémentaires du permis probatoire
Les titulaires du permis probatoire se verront attribuer progressivement, et non plus en une seule fois, des points supplémentaires. Ainsi, le conducteur concerné verra son capital initial de six points majoré de deux points par an s'il n'a pas commis d'infraction entraînant retrait de points depuis le début de la période probatoire, jusqu'à atteindre un total de douze points au bout de trois ans. En cas de suivi d'un apprentissage anticipé de la conduite, le capital sera majoré, dans les mêmes conditions, de trois points par an, pour atteindre douze points au bout de la deuxième année.
Cette mesure sera applicable aux permis de conduire obtenus à compter du 31 décembre 2007.
Paragraphes VI – Réduire les délais permettant de recouvrer son permis de conduire
La troisième mesure, d'application immédiate, permet d'inclure les démarches administratives dans le décompte du délai de six mois à l'expiration duquel la personne qui a perdu la totalité de ses points peut obtenir un nouveau permis.
Actuellement, l'article L.223-5 du code de la route dispose qu'en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis de conduire doit remettre au préfet son permis invalidé et ne peut solliciter un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet. Par ailleurs, il doit avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique à ses frais.
Or, aucune démarche ne peut être entreprise en vue de recouvrer son permis avant le terme du délai de six mois, à savoir: inscription, tests psychotechniques, visite médicale, épreuve théorique générale, et, le cas échéant, épreuve de conduite.
En pratique, un délai minimum supplémentaire de quatre à sept mois est nécessaire pour accomplir ces différentes formalités.
La loi modifie cet article en disposant que le titulaire du permis peut obtenir un nouveau permis dès six mois. Les démarches précitées pourront être effectuées dès la remise du permis de conduire en préfecture et le candidat pourra obtenir un nouveau permis six mois francs après la restitution de son précédent titre.
Paragraphes VII et VIII – La mesure dite « un point - un an »
La mesure « un point, un an » doit permettre aux conducteurs qui n'ont perdu qu'un point de le récupérer automatiquement, au bout d'un an (et non plus trois), s'ils n'ont pas commis de nouvelle infraction entre-temps.
Cette disposition est applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
Interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné (article 24)
Cet article punit d'une contravention de la 5ème classe la circulation sur les voies et espaces publics des deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur « non réceptionnés », c'est-à-dire n'ayant pas vocation à circuler sur les voies et espaces publics. En outre, il est désormais prévu que ces véhicules puissent être immobilisés, confisqués ou mis en fourrière (nouvel article L.321-1-1 du code de la route).
Enfin, les agents habilités à constater les infractions au code de la route, peuvent désormais décider de l'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées à l'article L.325-1 du code de la route (à savoir, véhicules dont la circulation ou le stationnement contreviennent aux dispositions du code de la route ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route, compromettant la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun ; véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols).
Auparavant, cette immobilisation n'était prononcée qu'à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Durcissement de la législation relative aux chiens dangereux (article 25)
Paragraphe I – Modifications du code rural
Le 1° définit plus clairement la circonstance de « danger grave et immédiat » qui permet au maire d'ordonner par arrêté que le chien soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde ou, le cas échéant, de faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal (article L.211-11).
2° – L'article L.211-14 du code rural subordonne la détention de chiens susceptibles d'être dangereux au dépôt d'une déclaration en mairie.
La loi complète cet article en prévoyant qu'en cas de défaut de déclaration, le maire (ou le préfet) met le propriétaire ou le détenteur de l'animal en demeure de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire (ou le préfet) peut ordonner par arrêté que le chien soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde ou, le cas échéant, faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal.
A noter que cette nouvelle infraction est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende.
Le 3° de cet article renforce, en outre les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les chiens dangereux. En particulier, la peine applicable en cas de détention illicite d'un chien dangereux est durcie (six mois d'emprisonnement, au lieu de trois, et 7.500 € d'amende, au lieu de 3.750 €).
Par ailleurs, est érigée en peine complémentaire, en plus de la confiscation de l'animal, l'interdiction de détenir un chien des deux premières catégories, pour une durée de cinq ans au plus.
Enfin, les personnes morales sont désormais pénalement responsables dès lors qu'elles commettent des infractions à la législation relative aux chiens dangereux (articles L.215-1 à L.215-3).
Paragraphe II – Modifications du code pénal
Le code pénal est modifié pour être cohérent au regard des changements apportés au code rural. Ainsi, ce paragraphe II:
- prévoit de façon expresse, outre la peine d'interdiction de détenir un animal, la peine de confiscation d'un animal, tant dans l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires que dans l'article 131-16 relatif aux peines contraventionnelles ;
- il définit de façon générale la peine complémentaire de confiscation de l'animal, celle-ci concernant aussi bien l'animal qui a été utilisé pour commettre l'infraction que l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Cet article général permet de distinguer la confiscation d'un objet de celle d'un animal, le code pénal distinguant déjà dans de nombreuses dispositions entre les animaux et les objets. Il règle par ailleurs de nombreux problèmes pratiques (remise de l'animal à une fondation ou à une association de protection animale, euthanasie lorsque l'animal est dangereux, frais à la charge du condamné...) ;
- il précise le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal, en indiquant notamment que sa durée maximale ne peut excéder cinq ans lorsqu'elle est prononcée à titre temporaire.
Subordination de la détention de chiens dangereux à l'évaluation comportementale du chien (article 26 – nouvel article L.211-14 du code rural)
Le maire peut demander une évaluation comportementale pour tout chien qu'il désigne, susceptible de présenter un danger.
Les frais de cette évaluation, qui doit être effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, sont à la charge du propriétaire de l'animal.
Evacuation forcée en cas de violation des règles sur le stationnement des gens du voyage (articles 27 et 28 – article 9 et nouvel article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage)
L'article 27 permet au préfet de procéder d'office, sur demande du maire ou du propriétaire du terrain, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, à l'évacuation forcée de terrains situés sur le territoire d'une commune respectant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage.
Cette procédure de police administrative se substitue ainsi à la procédure judiciaire en vigueur.
La mise en demeure par le préfet ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Les gens du voyage et le propriétaire du terrain peuvent contester la mise en demeure en introduisant un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la décision du préfet, le tribunal ayant alors l'obligation de statuer dans un délai de 72 heures.
Bénéficient des moyens de coercition offerts par cette nouvelle procédure de police administrative les communes:
- ayant satisfait à leurs obligations en matière de réalisation d'aires d'accueil,
- qui n'ont pas encore rempli leurs obligations légales mais qui répondent aux conditions posées pour obtenir la prorogation du délai de deux ans prévue par la loi n° 2007-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- qui disposent d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément préfectoral,
- autres que celles susmentionnées et non inscrites au schéma départemental (cf. article 28 de la loi).
La loi donne la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit d'usage du terrain de s'opposer à l'évacuation forcée du terrain dans le délai fixé par le préfet pour l'exécution de la mise en demeure.
Toutefois, celui-ci sera contraint de prendre lui-même des mesures pour faire cesser les troubles. A cette fin, le préfet pourra lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3.750 €.
Conditions du pouvoir de réquisition du préfet (article 29)
Cet article précise que le pouvoir de réquisition accordé au préfet en cas d'urgence et lorsque les moyens à sa disposition sont insuffisants, s'exerce non seulement dans l'hypothèse du rétablissement du bon ordre, de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publiques, mais également dans celle de la prévention de ces troubles (article L.2215-1 du CGCT).
Chapitre IV– dispositions fondées sur l'intégration
Ce volet « intégration » de la loi modifie, quant à lui, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et crée un service volontaire citoyen de la police nationale, en vue d'accomplir « des missions de solidarité, de médiation nationale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de toutes prérogatives de puissance publique » (article 30 de la loi).
Par ailleurs, l'article 32 indique que les périodes de temps consacrées à un contrat de service civil volontaire peuvent être intégrées dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques.
A noter que ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les trois fonctions publiques et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Chapitre V – dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui
Les dispositions contenues dans ce chapitre renforcent les dispositifs de prévention des actes violents pour soi-même ou pour autrui.
Jeux vidéo violents (article 35)
Afin d'accroître la protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques ou violentes et d'intensifier la lutte contre la pédophilie sur Internet, l'article 35-I modifie la législation relative au contrôle des vidéocassettes, des DVD et des jeux vidéos pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite à la violence.
Le paragraphe III de cet article renforce la lutte contre les comportements délictueux dont les mineurs peuvent être victimes par le biais d'Internet afin de permettre d'en réunir les preuves et d'en identifier les responsables. Il prévoit ainsi les initiatives que peuvent prendre à ce titre les officiers ou agents de police judiciaire, spécialement habilités et affectés dans un service spécialisé.
Jeux d'argent (article 38)
Afin de sanctionner les cas de publicité pour des activités illicites de jeux, cet article modifie les cinq textes législatifs encadrant les jeux d'argent (loteries, courses de chevaux, casinos, cercles de jeux) de façon:
- à porter à 30.000 € la peine d'amende encourue (aucune peine d'emprisonnement n'est en revanche prévue) ;
- à permettre au tribunal de porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Disparition d'enfants (article 41)
L'article 41 introduit dans le code pénal (article 434-4-1) une nouvelle infraction qui puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende « le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche ».
Délit d'embuscade (article 44)
L'article 44 précise les sanctions pénales encourues lorsque des violences sont commises avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée ou avec guet-apens, « sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission » (nouvel article L.222-14-1 du code pénal).
Il reprend en outre la notion de guet-apens, non seulement comme circonstance aggravante comme tel avait déjà été le cas dans le code pénal de 1810, mais aussi comme fondement d'une nouvelle infraction sous la forme du délit d'embuscade, constitué par « le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé » les agents précités « dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme ».
Chapitre VI – dispositions tendant à prévenir la toxicomanie et certaines pratiques additives
Ce chapitre envisage les mesures à prendre pour prévenir les addictions et sanctionner de manière plus sévère la commission d'infractions sous l'emprise de la drogue mais aussi en état d'ivresse manifeste.
L'article 48 complète le dispositif de lutte contre la toxicomanie, en créant des circonstances aggravantes à l'usage illicite de produits stupéfiants pour certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des circonstances aggravantes en cas de provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants envers les mineurs.
Ainsi, l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis notamment « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public » est punie de cinq d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende (article L.3421-1 du CSP).
Lorsque ce délit constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou aux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende.
A noter qu'est également prévue la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant aux frais des personnes coupables de ce délit, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (article L.3421-4 du CSP).
Enfin, le 3° de l'article 48 autorise le dépistage de l'usage de produits stupéfiants sur les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, auprès de certaines catégories de personnels, s'il existe une raison plausible de les soupçonner d'usage de produits stupéfiants (nouveaux articles L.3421-5 et suivants du CSP).
L'article 53 crée une nouvelle peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, qui pourra être prononcée s'agissant des infractions suivantes :
- atteintes à la vie des personnes et de mise en danger d'autrui (articles 221-8 et 223-18 du code pénal) ;
- atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne (article 222-44 du code pénal) ;
- extorsion (article 312-13 du code pénal) ;
- destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).
Enfin, l'article 54 institue une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste.
Chapitre VII – dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs
Les dispositions contenues dans ce chapitre recherchent la nécessaire articulation entre la prévention, l'éducation et la sanction pour les mineurs.
L'article 55 aménage certaines mesures alternatives aux poursuites applicables aux mineurs et étend la composition pénale, jusqu'alors réservée aux majeurs, aux mineurs sous réserve de plusieurs aménagements:
- la composition pénale doit être acceptée non seulement par le mineur mais aussi par ses représentants légaux ;
- cet accord doit être obligatoirement recueilli en présence d'un avocat, le cas échéant désigné d'office ;
- l'audition, à leur demande, du mineur et de ses représentants légaux devant le juge des enfants chargé de l'homologation est de droit.
Cette disposition laisse au procureur de la République la faculté de choisir parmi les mesures applicables aux majeurs celles qui seraient les mieux adaptées aux mineurs, sans toutefois que la mesure ne dépasse un an.
En outre, cinq mesures spécifiques sont proposées aux mineurs: l'accomplissement d'un stage de formation civique, le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, le respect d'une décision antérieure de placement dans une structure d'éducation ou de formation professionnelle, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue, l'exécution d'une mesure d'activité de jour.
L'article 56 ouvre la possibilité au juge des enfants de prescrire une mesure d'activité de jour, mesure créée par l'article 59 de la loi, qui consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire, pendant une durée maximale de douze mois.
L'article 57 étend les conditions d'application du contrôle judiciaire aux mineurs. Ainsi, le 1° complète la liste des centres dans lesquels peut s'effectuer le placement du mineur: outre les centres éducatifs de la PJJ et les centres relevant d'un service habilité, l'obligation de placement pourra également s'effectuer dans des « établissements permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique ».
Le 2° complète la liste des obligations spécifiques auxquelles peuvent être astreints les mineurs, portant leur nombre à quatre (le juge pouvant en prononcer une ou plusieurs). Les deux nouvelles obligations sont:
- l'accomplissement d'un stage de formation civique ;
- le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle jusqu'à la majorité de l'intéressé.
Enfin, le 3° étend les conditions de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans.
L'article 58 comporte quant à lui deux dispositions distinctes. Le 1° de cet article étend au tribunal pour enfants les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale, actuellement applicables au tribunal correctionnel, relatif au mode de fixation du nombre et du jour des audiences.
Le 2° substitue à l'actuelle procédure de « jugement à délai rapproché » une procédure dite de « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ».
Outre l'introduction de la possibilité pour le tribunal pour enfants de prononcer une mesure d'activité de jour à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, l'article 59 de la loi complète l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945, consacré aux sanctions éducatives pouvant être prononcées contre des mineurs d'au moins 10 ans par le tribunal pour enfants par décision motivée.
Cette catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines, comprend actuellement la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit, des interdictions temporaires de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, la mesure d'aide ou de réparation, ainsi que l'obligation de suivre un stage de formation civique.
Cet article ajoute quatre nouvelles sanctions éducatives :
- l'exécution de travaux scolaires,
- l'avertissement solennel,
- le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire,
- une mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un an pour les mineurs âgés de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis, et situé en dehors du lieu de résidence habituel.
Enfin, est précisément détaillé le contenu de la mesure d'activité de jour.
Aux termes de l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945, « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ».
L'article 60 de la loi complète l'article 20-2 suscité en ce qu'il dispense le tribunal pour enfants de l'obligation de motiver spécialement sa décision lorsqu'il souhaite ne pas faire bénéficier un mineur en situation de récidive légale du principe d'atténuation de la responsabilité prévu ci-avant
En l'état du droit, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue (article 20-2 de l'ordonnance de 1945).
L'article 60 de la loi, qui complète l'article 20-2 susvisé, prévoit que cette « excuse de minorité » peut désormais être levée dans des hypothèses strictement encadrées. En effet, s'il s'agit d'un mineur de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, « soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale » décider de ne pas retenir le principe d'atténuation de la peine.
Dans ce cas, la décision prise par le tribunal pour enfants doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale.
Chapitre VIII – dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général
Ce chapitre est consacré à la nécessaire adaptation des sanctions aux nouveaux comportements délinquants des majeurs qui peuvent être constatés. Pour une véritable prise de conscience du dommage causé à la victime, il est opportun de créer une sanction nouvelle, la « sanction-réparation », qui oblige l'auteur à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d'origine.
L'article 131-8 du code pénal précise que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public, d'une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
L'article 63 modifie la rédaction de l'article 131-8 en prévoyant que le travail d'intérêt général peut également être accompli au profit d'une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public.
L'article 64 institue une nouvelle catégorie de peine correctionnelle, la « sanction-réparation », à savoir l'obligation pour le condamné de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l'indemnisation de la victime.
Le champ de la sanction-réparation est applicable non seulement aux délits punis d'une peine d'emprisonnement mais aussi aux délits punis d'une seule peine d'amende, ainsi qu'aux contraventions de la 5ème classe.
Cette peine est également encourue par les personnes morales.
Avec l'accord de la victime, cette réparation peut être exécutée en nature. En pareille hypothèse, elle peut consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de l'infraction, cette remise en état pouvant alors être réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
En matière contraventionnelle, la juridiction détermine le montant maximum de l'amende, qui ne peut dépasser 1.500 €, dont le juge de l'application des peines pourra décider la mise à exécution si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
S'il s'agit d'un délit, le montant de l'amende ne peut dépasser 15.000 € (et 75.000 € pour les personnes morales).
Enfin, la remise en état d'un bien endommagé constitue l'une des modalités de l'obligation de réparation susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une composition pénale.
Chapitre IX – dispositions diverses
L'article 74-I modifie les dispositions du CGCT et renforce les pouvoirs des gardes champêtres. A ce titre, il:
- étend aux gardes champêtres la compétence accordée aux policiers municipaux par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances en matière de constatation des contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de celles qui nécessiteraient de leur part des actes d'enquête ou de celles qui réprimeraient des atteintes à l'intégrité des personnes. Jusqu'alors, cette prérogative était réservée aux officiers de police judiciaire et aux agents de police judiciaire qui les secondent (article L.2213-18).
- accorde aux gardes champêtres, pour constater ces infractions, la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, dont les missions sont définies à l'article 21 du code de procédure pénale (à savoir seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions). L'article 21 précise que, lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant (article L.2213-19).
- et étend aux contraventions constatées par les gardes champêtres la prérogative, accordée au maire par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, de proposer une transaction au contrevenant: l'article 51 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (article 44-1 du code de procédure pénale) a en effet attribué au maire, pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le pouvoir de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice, la transaction pouvant aussi consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures.
Cette transaction ne peut être proposée que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Si elle est acceptée par le contrevenant, elle doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Mesures intéressant directement les communes et les EPCI
Article 1er : Le rôle du maire en matière de prévention de la délinquance
Les Conseils Locaux et Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
La participation des conseils généraux à la prévention de la délinquance
L'information du maire par la police et gendarmerie nationales et la Justice
La prise en charge par un EPCI des dispositifs de vidéosurveillance
Article 2: La présence de travailleurs sociaux dans les commissariats et gendarmeries
Article 3: L'exercice par une commune ou une communauté des compétences du département dans le domaine de l'action sociale
Article 4: La mise en commun d'agents de police municipale par des communes
Article 5: Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Article 6: La participation des autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs à la prévention de la délinquance
Article 7: La participation du procureur de la République à la prévention de la délinquance
Les modalités d'échange d'informations entre la Justice et le maire
Article 8: L'information du maire de la nécessité de faire appel à plusieurs professionnels de l'action sociale
La désignation d'un coordonnateur par le maire
Le partage de l'information entre professionnels de l'action sociale
Le partage de l'information entre les professionnels de l'action sociale et le maire
L'information du maire lorsqu'un mineur est susceptible d'être en danger
Article 9: Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Famille
La proposition du maire de la mise en œuvre d'un « accompagnement parental »
Article 10: La saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle des prestations familiales
Article 11: Le rappel à l'ordre effectué par le maire
Article 12: Le recensement et le suivi des enfants soumis à l'obligation scolaire par le maire
Article 14: La réalisation d'une étude de sécurité publique
Article 16: La contribution des communes ou des EPCI à l'obligation de gardiennage ou de surveillance prévue pour certains immeubles
Article 17: L'exécution d'office par le maire des mesures nécessaires pour mettre fin au danger résultant de la présence de matières explosives ou inflammables dans un immeuble
Article 19: La mise en demeure du maire au propriétaire d'un ensemble commercial en vue de sa réhabilitation en cas de dégradation ou d'absence d'entretien
Article 21: La rétention du véhicule des personnes ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français en cas de non paiement de certaines contraventions
La prise en charge des véhicules réputés abandonnés
Articles 25 et 26: Le renforcement des dispositions relatives aux animaux dangereux
Articles 27 et 28: La mise en demeure du préfet aux gens du voyage de quitter un terrain lorsque le stationnement de leurs résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'ordre public
Article 29: L'extension des pouvoirs de police du préfet dans certaines situations pour faire respecter l'ordre public
Article 74: L'élargissement des compétences des gardes champêtres
La possibilité pour le maire de proposer une transaction aux contrevenants sanctionnés par les gardes champêtres
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.