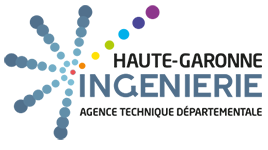Comment revenir sur les décisions prises par l'ancienne équipe municipale
Les nouvelles équipes municipales issues des élections de mars 2014 sont installées et les premières décisions relatives à l'organisation de la commune ont été prises: attribution des délégations de fonction et de signature, vote du régime indemnitaire, mise en place des commissions municipales, désignation des représentants communaux dans les organismes extérieurs. A cette mise en route succède maintenant la mise en œuvre des projets communaux, tels qu'ils ont été notamment annoncés pendant la campagne électorale. Or, dans cette tâche, il peut arriver que les nouvelles autorités municipales se trouvent contraintes par des décisions de leurs prédécesseurs qui compromettent, notamment d'un point de vue financier, la réalisation de leurs projets.
La question est donc de savoir dans quelle mesure il leur est possible de revenir sur de telles décisions et de rompre ainsi des engagements passés. Un nouveau maire peut-il ainsi revenir sur une délibération approuvant l'acquisition d'un terrain ou encore renoncer à la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu avec une entreprise ?
Ces questions se rattachent à la problématique générale de la disparition des actes administratifs au sein desquels il convient de distinguer les décisions unilatérales (délibérations, arrêtés, autorisations...) des contrats (marchés, conventions, baux ...). Ces deux catégories d'actes ont chacune, en la matière, un régime juridique qui leur est propre si bien que les prérogatives des nouvelles autorités municipales et les conséquences financières pouvant en découler seront bien différentes selon qu'il s'agira de remettre en cause des décisions unilatérales ou de remettre en cause des contrats.
Il existe d'ailleurs un vocabulaire propre à chacun des ces actes. Ainsi, lorsque la remise en cause d'une décision unilatérale vaut pour l'avenir, on parle alors d'abrogation de la décision tandis que si elle vaut pour le passé, on parle alors de retrait de la décision, celle-ci étant censée n'avoir jamais existé. S'agissant de la remise en cause des contrats, on parle plus couramment de résiliation.
Une autorité municipale peut être indifféremment confrontée à ces questions d'abrogation, de retrait et de résiliation. Elles seront donc examinées successivement.
La remise en cause pour l'avenir des décisions administratives unilatérales
Les possibilités d'abrogation d'une décision unilatérale diffèrent selon qu'il s'agit d'une décision règlementaire ou d'une décision individuelle. Le caractère régulier ou non de la décision conditionne en outre les prérogatives de l'autorité municipale en la matière.
Une décision règlementaire est celle qui est de portée générale et qui s'applique à tous (ex: un arrêté de police règlementant la circulation des véhicules, le règlement de la cantine scolaire).
Une décision individuelle s'applique à une personne nommément désignée et elle est généralement créatrice de droits pour son bénéficiaire (ex: un permis de construire, l'attribution d'une subvention).
L'abrogation des décisions règlementaires
La faculté d'abroger: Il est toujours possible d'abroger – pour l'avenir – une décision règlementaire, quelle que soit la forme empruntée par cette décision (délibération, arrêté, règlement...). Cette abrogation peut intervenir à tout moment.
Ainsi, un conseil municipal peut abroger, en tout ou partie, les règlements des services publics locaux (eau, assainissement, déchets, accueil de loisirs, école de musique ...), les règles d'utilisation des biens communaux (locaux, voirie, cimetière, salle des fêtes...) ou encore la tarification des services publics. Le maire dispose de la même faculté d'abroger les décisions règlementaires relevant de sa compétence, notamment celles prises au titre de la police municipale en vue de préserver la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique (ex: règlementation des déchets, de la baignade, du bruit) ou de ses prérogatives en tant que chef de l'administration communale (ex: règles d'organisation des services, règlementation des horaires de travail des agents communaux).
Généralement une décision d'abrogation tend à modifier partiellement une décision existante ou à la remplacer par une autre. Mais elle peut aussi la faire disparaître purement et simplement.
En outre, l'abrogation n'est pas cantonnée à un acte. Elle peut concerner des services publics et des ouvrages publics. Ainsi, un conseil municipal peut supprimer une école municipale de musique ou une piste de bi-cross en abrogeant les délibérations ayant créé cette école ou cet équipement. Ces suppressions ne peuvent cependant concerner que des services et ouvrages publics facultatifs et non ceux qui sont obligatoires (ex: services publics de collecte et de traitement des déchets ménagers, de distribution d'eau, d'assainissement – cimetières, hôtel de ville).
Le juge exerce un contrôle restreint sur l'abrogation des décisions règlementaires en application du principe selon lequel « nul n'a droit au maintien d'une situation règlementaire » (CE Section, 27 janvier 1961, Vannier, R.60). Il vérifie simplement que la décision d'abrogation repose sur un motif d'intérêt général qui peut notamment tenir à des considérations règlementaires, circonstancielles ou financières. Ainsi la suppression de l'école de musique peut reposer sur un motif financier (déficit d'exploitation) tandis que la suppression de la piste de bi-cross peut être justifiée par la nécessité d'affecter le terrain à une autre fin d'intérêt général (création de logements).
Si toutefois des règles de fond, de forme ou de procédure sont expressément prescrites par un texte pour procéder à l'abrogation d'un acte, le juge vérifie que ces règles ont bien été respectées (ex: la suppression d'un emploi nécessite le respect des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'avis préalable du comité technique).
Le juge contrôle par ailleurs que la décision d'abrogation n'a d'effets que pour l'avenir. Ainsi une délibération du conseil municipal modifiant les tarifs de consommation d'eau potable ne s'applique qu'aux consommations enregistrées postérieurement à cette délibération et non aux consommations passées. De même, une décision modifiant les règles d'utilisation de la salle des fêtes interdisant l'organisation de repas ne peut remettre en question une précédente autorisation d'occupation qui ne comportait pas cette interdiction.
Cependant, l'effet non rétroactif d'une décision d'abrogation ne s'applique pas aux situations en cours. Ainsi, l'autorité municipale doit instruire et délivrer une autorisation d'occupation de la salle des fêtes conformément aux nouvelles règles d'utilisation alors même que la demande d'utilisation a été déposée avant la décision d'abrogation des anciennes règles.
L'obligation d'abroger: Dans certaines situations, l'autorité municipale est tenue d'abroger des décisions règlementaires. Cette obligation, posée initialement par le juge administratif (CE Ass., 3 février 1989, Alitalia R.44), a été consacrée et complétée par le législateur. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (article 16.1) oblige l'administration à abroger, d'office ou à la demande d'une personne qui y a intérêt, tout règlement qui est illégal ou sans objet, que cette illégalité existe depuis l'origine ou qu'elle résulte, soit d'un changement de la règlementation, soit d'un changement dans la situation de fait qui avait conduit à son édiction.
Ainsi, l'autorité municipale doit abroger, spontanément ou à la demande d'un usager, une disposition règlementaire illégale (ex: un article du règlement du service de distribution d'eau qui affranchit la commune de toute responsabilité envers les usagers en cas de coupure d'eau, quel qu'en soit le motif).
Elle doit également mettre ses règlements en conformité avec de nouvelles règles (ex: obligation de modifier les tarifs de l'eau pour les mettre en conformité avec les nouvelles règles de tarification, obligation d'insérer dans le règlement du service de distribution d'eau l'obligation légale d'individualisation des compteurs d'eau).
Elle doit également adapter ses règlements aux changements dans les circonstances de fait (ex: un arrêté de police interdisant la randonnée sur un chemin de montagne en raison d'un risque d'avalanche doit être abrogé dés lors que ce risque a disparu).
Ainsi, une autorité municipale ne doit jamais appliquer un règlement illégal.
L'abrogation des décisions individuelles
Une décision individuelle s'applique à une personne donnée et le régime de son abrogation diffère selon qu'elle est créatrice de droits ou non.
Une décision individuelle n'est pas créatrice de droits lorsqu'elle a un caractère purement recognitif (ex: attestation de réussite à un examen, certificat de concubinage,) ou déclaratif (arrêté individuel de délimitation du domaine public) ou encore qu'elle est défavorable à son destinataire (refus, sanction). N'est pas davantage créatrice de droit la décision de liquidation (calcul) ou de paiement d'une somme.
Elle est créatrice de droits lorsque l'autorité municipale détient un pouvoir, notamment d'appréciation, pour conférer ces droits. Il en va également de toutes les décisions pécuniaires (CE, sect., 6 nov. 2002, Soulier, n° 223041).
Lorsqu'une décision individuelle est créatrice de droits pour son bénéficiaire (ex: nomination d'un fonctionnaire, autorisation de stationnement, permis de construire, versement d'une indemnité), elle ne peut être abrogée qu'à la double condition:
d'être illégale
que son abrogation intervienne dans un délai de 4 mois à compter de son édiction (CE, sect., 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084).
Une autorité municipale peut par exemple abroger, dans un délai de 4 mois à compter de l'édiction de l'acte:
une délibération décidant de vendre un chemin rural au motif que l'enquête publique obligatoire n'a pas eu lieu,
l'arrêté de mise à disposition d'un agent pour défaut d'avis préalable des instances consultatives compétentes,
l'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons au motif que la licence d'exploitation est périmée.
Il appartient à l'autorité municipale d'apprécier l'illégalité dont est entachée la décision individuelle sans en référer préalablement au juge administratif. Ce dernier peut cependant annuler une décision d'abrogation s'il considère que le motif d'illégalité n'est pas fondé. Une abrogation illégale est d'ailleurs susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Il existe des exceptions et des aménagements aux deux conditions de délai et d'illégalité exigées pour l'abrogation d'une décision individuelle créatrice de droits. Ainsi, l'autorité municipale peut toujours abroger une telle décision lorsque:
l'abrogation intervient à la demande de son bénéficiaire, en particulier, lorsque celui-ci a intérêt à obtenir une décision plus favorable (ex: une durée d'autorisation plus longue),
le bénéficiaire ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier des droits qui se rattachent à la décision (ex: le versement d'une prime à un agent doit, pour l'avenir, être supprimé lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour bénéficier de cette prime),
l'abrogation concerne une autorisation d'occupation privative du domaine public (ex: autorisation d'installer une terrasse de café sur le trottoir d'une voie communale, permission de voirie pour la réalisation de travaux dans l'emprise d'une voie publique) ; si une telle décision crée effectivement des droits pour son bénéficiaire, elle néanmoins est toujours délivrée à titre précaire et révocable, conformément à l'article L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques et peut par conséquent être abrogée, à tout moment, pour un motif d'intérêt général ; seules échappent à ce pouvoir d'abrogation, les concessions funéraires.
Lorsque la décision individuelle n'est pas créatrice de droits, l'autorité municipale peut l'abroger ou la modifier à tout moment.
Ainsi, la décision attributive d'une subvention peut être abrogée sans délai lorsqu'il existe une erreur de calcul dans le montant attribué et que celui-ci n'est pas encore versé à son bénéficiaire.
Par ailleurs, une décision individuelle obtenue par fraude (ex: production de faux documents par le bénéficiaire) ne peut jamais faire naître des droits. Elle peut donc être abrogée sans condition de délai (CE Section, 18 novembre 1955, Silberstein, R.334).
La remise en cause pour le passé des décisions administratives unilatérales
Le régime du retrait – pour le passé – d'une décision unilatérale est commandé, comme pour l'abrogation, par la nature règlementaire ou individuelle de cette décision et par son caractère régulier ou non.
Le retrait des décisions règlementaires
Le retrait est impossible, même si l'acte règlementaire est illégal. Il ne peut faire l'objet que d'une abrogation (voir supra).
En effet, l'autorité municipale ne peut pas revenir sur le passé au nom du principe de non rétroactivité des actes administratifs. Elle ne peut davantage, au nom de la stabilité juridique des droits acquis, remettre en cause les décisions individuelles qui ont été prises en application d'une décision règlementaire.
Un conseil municipal ne peut, par exemple, retirer – pour le passé – la délibération décidant d'attribuer une prime à tous les jeunes ménages venant s'installer sur la commune car cela reviendrait à remettre en cause les primes déjà versées. Il peut seulement supprimer cette prime pour l'avenir.
Les seules exceptions qui existent à l'impossibilité de retirer un acte règlementaire sont liées aux cas où le délai de recours contentieux de 2 mois à l'encontre de cet acte n'a pas expiré ou, si le juge a été saisi, tant qu'il n'a pas statué. Dans ces deux cas, le retrait est possible.
Le retrait des décisions individuelles
Comme pour l'abrogation, le régime du retrait est commandé par les droits que la décision individuelle a fait naître ou pas (voir supra).
Lorsqu'une décision individuelle est créatrice de droits pour son bénéficiaire, elle ne peut être retirée qu'à la double condition:
d'être illégale
que son retrait intervienne dans un délai de 4 mois à compter de son édiction (CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, n° 197018).
Une autorité municipale peut par exemple retirer, dans un délai de 4 mois à compter de son édiction et sous réserve de son illégalité, une décision portant :
nomination, titularisation ou promotion d'un fonctionnaire,
vente d'une parcelle du domaine privé communal à un particulier,
autorisation de construire, de démolir, d'aménager,
intégration dans le domaine public communal du réseau routier et de l'éclairage public d'un lotissement,
attribution d'indemnités de fonction à un élu.
Il convient de noter que l'autorité municipale a l'obligation de procéder au retrait d'une décision individuelle illégale lorsque la demande lui en est faite par un administré dans le délai susmentionné de 4 mois. En l'absence d'une telle demande, elle apprécie l'opportunité d'y procéder.
Le retrait a pour effet de faire disparaître rétroactivement une décision (elle est censée n'avoir jamais existé) et de rétablir la situation juridique initiale. Il entraîne donc la disparition des droits nés de cette décision (ex: le retrait de la décision d'attribution d'une prime versée à tort doit entrainer la restitution de cette prime).
Comme pour l'abrogation, il convient de relever que l'autorité municipale :
- n'est pas enfermée dans ces 2 conditions de délai et d'illégalité lorsque le retrait d'une décision individuelle intervient à la demande de son bénéficiaire, en particulier, lorsque celui-ci a intérêt à obtenir une décision plus favorable,
- apprécie elle-même l'illégalité de l'acte sous le contrôle du juge administratif qui peut censurer un retrait illégal et engager la responsabilité de la commune.
Lorsqu'une décision individuelle n'est pas créatrice de droits pour son bénéficiaire, son retrait peut être prononcé à toute époque.
Comme en matière d'abrogation, une décision obtenue par fraude ne peut jamais créer de droits si bien qu'elle peut être retirée à tout moment (ex: retrait d'une décision d'admission à la retraite en raison de la falsification par l'intéressé des pièces attestant de ses droits).
La résiliation des contrats administratifs
La résiliation concerne tous les contrats administratifs, qu'il s'agisse de marchés publics, de délégations de services publics ou de contrats d'occupation du domaine public y compris ceux de longue durée et constitutifs de droits réels tels que les baux emphytéotiques administratifs (BEA).
Le pouvoir de résiliation unilatérale
L'autorité municipale peut mettre fin à tout moment à un contrat administratif pour un motif d'intérêt général. Il s'agit d'une prérogative qu'elle détient même en l'absence de stipulations écrites (CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval). Toute disposition contractuelle faisant obstacle à cette prérogative est d'ailleurs illégale (CE, 6 mai 1985, association Eurolat c/ Crédit Foncier de France, n° 41589 et 41699).
Constituent, par exemple, des motifs d'intérêt général:
l'abandon d'un projet ne répondant plus aux besoins de la commune (ex: abandon du projet de construction d'une classe supplémentaire suite à l'adhésion de la commune à un regroupement pédagogique intercommunal - RPI),
le changement d'objectifs (ex: abandon des travaux d'amélioration du réseau d'eau au profit de l'aménagement d'un nouveau réseau),
la réorganisation du service public (ex: reprise en régie directe d'une prestation exécutée par une entreprise),
la modification de la réglementation (ex: la réforme de 2013 sur les rythmes scolaires qui peut impacter les contrats d'animation scolaires conclus en cette matière),
un motif financier (refus par le cocontractant d'accepter une augmentation de la redevance d'occupation).
L'illégalité du contrat est également un motif d'intérêt général dont peut se prévaloir l'autorité municipale (ex: conclusion d'un contrat par un adjoint en dehors de toute délégation de fonctions). Mais lorsqu'elle se prévaut d'une illégalité, le juge administratif encadre son pouvoir de résiliation unilatérale (voir infra).
Le droit à indemnisation du cocontractant
La décision de résiliation pour motif d'intérêt général du contrat ouvre droit, selon une jurisprudence constante, à la réparation intégrale du préjudice subi par le cocontractant, qui couvre le manque à gagner dont il a été privé et les éventuelles dépenses qu'il a exposées en vue de l'exécution de la prestation (par exemple : CE, 16 février 1996, Syndicat intercommunal de l'arrondissement de Pithiviers, n° 82880).
Le cocontractant ne pourra être dédommagé de l'intégralité du dommage qu'il a subi qu'à la condition qu'il puisse en justifier le montant et que cela n'aboutisse pas à un enrichissement indu. Si la résiliation concerne un marché public, le cocontractant sera en droit de demander d'une indemnité correspondant à la perte de bénéfices et aux éventuelles dépenses engagées en vue de l'exécution du contrat. Dans le cadre d'une délégation de service public c'est la perte des redevances d'exploitation qui seront indemnisées. Pour un simple contrat d'occupation du domaine public (ex: logement d'instituteur), c'est le préjudice matériel qui sera indemnisé à condition que le contractant prouve sa réalité (ex: frais de relocation dans un logement privé, déménagement, loyer plus élevé, ...).
Les modalités de l'indemnisation peuvent être déterminées par le contrat sous réserve qu'elles n'aboutissent pas au versement d'une indemnité supérieure à celle à laquelle peut prétendre le cocontractant. Mais elles peuvent limiter le droit à indemnité du cocontractant. Dans le silence du contrat, le montant de l'indemnité est négocié entre les parties et donne lieu à la conclusion d'une transaction approuvée par l'assemblée délibérante.
Un pouvoir de résiliation encadré par le juge
En cas de refus de la transaction, le cocontractant peut saisir le juge administratif pour contester la décision de résiliation dans les deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure (CE, 21 mars 2011, Cne de Béziers, n°304806).
Le juge apprécie le bien-fondé du motif d'intérêt général invoqué par l'autorité municipale et contrôle que la décision de résiliation est exempte de vices relatifs à sa régularité. Si tel n'est pas le cas, il peut censurer cette décision et ordonner la reprise des relations contractuelles.
Par ailleurs, lorsque la décision de résiliation repose sur un motif d'illégalité du contrat, le juge en contrôle la régularité au regard de la gravité de l'illégalité invoquée par l'autorité municipale.
En effet, depuis 2009, dans le cas de litiges entre les parties à un contrat administratif, toute illégalité n'entraîne plus systématiquement la nullité du contrat en vertu du principe de « loyauté des relations contractuelles ».
Ce principe impose au juge de faire prévaloir le contrat sur l'illégalité dont il est entaché sauf si cette illégalité est d'une particulière gravité au regard notamment des conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (CE, sect., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802).
Le Conseil d'Etat estime, d'une manière générale, que l'incompétence du signataire du contrat constitue une irrégularité suffisante pour en écarter l'application sauf si elle peut être régularisée. Il admet donc que la personne publique puisse prendre ou reprendre le ou les actes viciés ou inexistants et signer à nouveau le contrat (CE, 23 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302).
Il est difficile de dresser une typologie des irrégularités, autres que le vice du consentement, affectant irrémédiablement un contrat administratif. Tout va dépendre de la nature du contrat.
Constitueront ainsi de graves irrégularités le fait :
d'affranchir délibérément un marché public des formalités de publicité et de mise en concurrence afin de favoriser un candidat ;
de conférer au contractant des pouvoirs de police alors que ces pouvoirs ne peuvent être délégués ;
d'attribuer au délégataire d'un service public le pouvoir de fixer les redevances perçues auprès des usagers alors que celles-ci doivent être fixées par l'autorité délégante ;
de conférer un droit d'occupation ou de passage permanent sur le domaine public.
En toute hypothèse, le juge a le pouvoir de moduler la sanction en fonction de la gravité de l'irrégularité. Il peut ainsi prononcer la résiliation du contrat, modifier certaines de ses clauses, décider la poursuite du contrat après régularisation du vice l'affectant ou prononcer son annulation.
En conclusion, les nouvelles autorités municipales issues des élections peuvent, à tout moment, abroger un acte règlementaire édicté par les autorités précédentes, pour un motif d'intérêt général. La décision d'abrogation peut conduire à la suppression pure et simple de cet acte ou seulement à sa modification. Elle ne vaut que pour l'avenir.
En revanche, les nouvelles autorités municipales ne peuvent jamais retirer un acte règlementaire, c'est-à-dire le faire disparaître rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé.
S'agissant des décisions individuelles créatrices de droit, elles ne peuvent être abrogées ou retirées qu'à la condition d'être illégales et qu'un délai supérieur à 4 mois ne se soit pas écoulé depuis leur édiction. Passé ce délai, de telles décisions, même illégales, ne peuvent être, ni abrogées, ni retirées.
En revanche, peuvent être abrogées ou retirées à tout moment, les décisions individuelles non créatrices de droit, les décisions individuelles créatrices de droits obtenues par fraude ainsi que celles dont l'abrogation ou le retrait est demandé par leurs bénéficiaires afin d'obtenir une décision plus favorable.
Les nouvelles autorités municipales peuvent résilier unilatéralement, pour un motif d'intérêt général, les contrats en cours d'exécution conclus par leurs prédécesseurs. En contrepartie, les cocontractants doivent être indemnisés à hauteur du préjudice qu'ils subissent à raison de cette résiliation. Toutefois, lorsque la résiliation est motivée par l'irrégularité du contrat, le juge ne l'admet que si l'irrégularité est d'une particulière gravité. A défaut, il censure la décision de résiliation et ordonne la reprise des relations contractuelles.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.