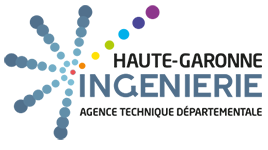La loi égalité et citoyenneté Les mesures concernant les collectivités locales (loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017)
07/09/2018
Afin de répondre aux attentes d’une société fragilisée par une crise économique et une série d’attentats sur son territoire, le gouvernement a voulu rassembler les citoyens autour de valeurs républicaines.
Selon le gouvernement « la loi encourage l’engagement citoyen tout au long de la vie et renforce la priorité à la jeunesse. Elle propose un modèle de société reposant sur une citoyenneté active, sur des valeurs de fraternité, d’altruism et de générosité ».
Deux comités interministériels "Égalité et citoyenneté" (CIEC) ont dégagé soixante mesures au sein d’un plan « pour la République en actes » au cours de l’année 2015.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté constitue le volet législatif de ce plan.
Rassemblant des thématiques très diverses, ce texte de 224 articles s’organise autour de 3 axes qui constituent les 3 titres de la loi :
- L’émancipation des jeunes, la citoyenneté et la participation
- La mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat
- L’égalité réelle entre les citoyens (lutte contre les déterminismes sociaux)
Cette Actualité juridique présente les mesures qui concernent directement ou indirectement les collectivités territoriales.
Nous avons distingué les dispositions relatives à l’urbanisme.
L’émancipation des jeunes, la citoyenneté
L’engagement républicain
La réserve civile (articles 1 à 9)
La réserve civile donne la possibilité à tout citoyen de participer bénévolement à un projet d’intérêt général (solidarité, médiation sociale, éducation, sécurité du territoire…). Elle permet de développer « la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale ».
Elle peut comporter des sections territoriales instituées par conventions adoptées entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
Elle est ouverte à toute personne majeure ou de 16 ans révolus avec l’accord parental préalable et remplissant les conditions prévues pour le service national (article L.120-4 du code du service national).
Les missions sont définies par des personnes morales de droit public ou des organismes sans but lucratif.
Les grands principes de cette réserve seront précisés par une charte fixée par décret.
Congé d’engagement associatif (article 10)
Un congé est accordé à tout salarié (article L.3142-54-1 du code du travail) ou à tout fonctionnaire (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires territoriaux) :
- pour siéger à la direction ou au conseil d’administration d’une association loi 1901 déclarée depuis au moins 3 ans ;
- pour siéger dans les instances internes d’un conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville ainsi qu’aux projets de renouvellement urbain ;
- pour apporter son concours personnel et bénévole à une mutuelle, une union ou une fédération en dehors de son contrat de travail ou de son statut de fonctionnaire.
Ce congé non rémunéré est de 6 jours par an et peut être fractionné par demi-journée. Dans le secteur privé, une convention, un accord d’entreprise ou un accord de branche fixe les conditions de sa mise en œuvre pour un salarié ainsi que le maintien de la rémunération du salarié pendant sa durée.
Généralisation du service civique (articles 17 à 25)
Le service civique ouvert aux jeunes volontaires de 18 à 25 ans est étendu aux organismes d’HLM, aux sociétés d’économie mixte, aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ainsi qu’aux entreprises publiques détenues à 100 % par l’Etat.
Le préfet anime le développement du service civique avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et des organismes agréés.
Il est actuellement envisagé le recrutement de 350 000 jeunes en service civique.
Personne volontaire lauréate d’un concours de la fonction publique
Le candidat, en service civique, inscrit sur une liste d’aptitude suite à un concours de la fonction publique bénéficie de la suspension du délai de 4 ans de validité du concours qui court à compter de son inscription et ceci jusqu’à la fin de son service civique.
Les sapeurs pompiers volontaires
Au terme de leur formation initiale, les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours (article L.1852-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT)).
Des mesures dédiées à l’engagement associatif des jeunes
Les cadets de la défense (article 26)
A titre expérimental, un programme civique comportant une découverte des armées et de leurs métiers, ainsi qu’un enseignement civique et moral, sera accessible aux Français âgés de 12 à 18 ans.
Validation des compétences des étudiants ayant exercé une activité bénévole (article 29)
Les compétences acquises par un étudiant dans le cadre d’activités bénévoles au sein d’une association loi 1901, d’une activité dans la réserve opérationnelle militaire, d’un engagement de sapeur pompier volontaire ou d’un service civique, sont validées au titre de sa formation selon des modalités fixées par décret.
Action citoyenne dans l’enseignement secondaire et supérieur (articles 33 à 40)
Les collégiens et lycéens sont incités à participer à un projet d’intérêt général au sein d’une association dans le cadre de l’enseignement moral et civique.
Des aménagements dans l’organisation des études et des droits seront accordés aux étudiants exerçant des responsabilités au sein d’une association, de missions civiques ou d’un volontariat militaire.
La majorité associative fixée à 16 ans (article 43)
Tout mineur peut devenir membre d’une association, participer à sa constitution ainsi qu’à sa gestion, à l’exception des actes de dispositions (transfert de biens). L’accord parental sera exigé uniquement pour les mineurs de moins de 16 ans. La majorité associative est ainsi fixée à 16 ans.
Nomination d’un mineur en qualité de rédacteur ou co-directeur de publications destinées à la jeunesse (article 41)
A titre dérogatoire à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un mineur pourra être nommé rédacteur ou co-directeur de publication d’un journal, d’un écrit périodique ou d’une communication audiovisuelle réalisés bénévolement. Son activité engagera la responsabilité de ses parents uniquement dans le cas d’une faute personnelle.
les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie
Service décentralisé de la petite enfance (article 53)
Le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance le 1er février 2017. A partir de ce rapport une réflexion sera menée sur l’amélioration de l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants dans le cadre d’une égalité réelle entre les territoires.
Accès des jeunes aux informations concernant tous les aspects de leur vie quotidienne (article 54)
Une attention particulière est apportée à une information fiable et de qualité dans tous les domaines pouvant toucher la vie des jeunes que ce soit en matière d’accès aux droits sociaux, à la santé, aux loisirs ou à l’orientation professionnelle.
La région coordonne les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des structures spécialisées dans ces multiples domaines.
Conseil des jeunes (article 55)
Les collectivités territoriales et les EPCI peuvent créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions (nouvel article L.1112-23 du CGCT).
Ces conseils se composent de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. La parité homme-femme doit être respectée. Les modalités de fonctionnement de ces conseils et leur composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.
Les contrats de ville (article 61)
Les contrats de ville encouragent des mesures de développement économique et social de quartiers urbains en difficulté. Les contrats conclus depuis le 1er janvier 2017 devront définir des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse ainsi que dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Livret d’épargne pour le permis de conduire (article 67)
Un livret d’épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit ainsi que par tout établissement conventionné par l’Etat. Il est ouvert un livret par personne avec un montant de versements limité fixé par décret.
Mixité sociale et égalité des changes dans l'habitat
Dans le cadre de l’accès au logement social, des mesures sont engagées par le gouvernement afin de favoriser la mixité sociale et lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale de certains quartiers.
Pour favoriser la mixité sur les territoires, la loi agit sur deux leviers :
- le parc social existant, en réformant les attributions des logements sociaux et les politiques de loyers pratiquées afin d’encourager la mixité sociale,
- l’offre de logements, en veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité et son adaptation aux besoins et aux revenus des ménages.
Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux (articles 70 à 79)
Des règles d'attribution rendues publiques
La loi oblige, à l'échelle intercommunale, l’ensemble des acteurs du logement à rendre publics les critères d’attribution choisis. Les modalités du choix des dossiers soumis à la commission d’attribution seront explicitées. Les candidats pourront ainsi comprendre l’état d’avancement de leur demande.
( Précisions apportées par l'Instruction NOR : TERI1806861J du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville - Cette instruction définit les conditions de mise en œuvre de dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté en matière d’attribution de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville visant à favoriser la mixité sociale dans ces quartiers).
Critères de priorité dans le logement social
Actuellement, les personnes en situation de handicap, les personnes mal logées défavorisées et les personnes victimes de violences conjugales font partie des publics prioritaires. La loi élargit les critères en y ajoutant les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs
Une plus grande souplesse est donnée aux bailleurs sociaux dans la fixation des loyers pour favoriser l’accueil des locataires aux profils plus diversifiés au sein des immeubles.
Un logement social choisi
Tous les bailleurs sociaux devront publier avant 2022, notamment sur internet, les logements sociaux vacants. Un demandeur de logement social pourra se positionner sur ces logements et être classé en fonction de critères de priorité transparents et connus.
25 % des logements des quartiers les plus prisés réservés aux demandeurs les plus modestes
Pour mieux répondre aux besoins de logement des plus fragiles, les collectivités locales et Action Logement (anciennement 1 % logement) devront consacrer 25 % de leurs attributions de logement aux ménages prioritaires.
La loi supprime la possibilité pour le préfet de déléguer aux communes le contingent de 30 % de logements réservés de l’État.
renforcer la démocratie locative dans le logement social
Renforcement des obligations de production de logement social en fonction des besoins et des réalités des territoires
Près d’un quart du parc social est situé dans une zone urbaine sensible Pour rééquilibrer l’offre, la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 est modifiée. Elle prévoit dorénavant que les principales agglomérations soient dotées de 20 à 25 % de logements sociaux d’ici à 2025. Par ailleurs, le périmètre d’application de cette loi est redéfini pour assurer une bonne adéquation avec la réalité des besoins. Il est recentré sur les territoires où la pression sur la demande en logement social est la plus forte.
Pour l'égalité réelle entre les citoyens
Selon le gouvernement, « l’égalité réelle permet d’offrir à chacun la possibilité de s’insérer pleinement dans la République. Il s’agit également de lutter contre les déterminismes sociaux qui empêche l’ascension sociale ».
Les conseils citoyens (articles 153 à 156)
La loi reconnaît aux citoyens dans le cadre de « conseils citoyens » le droit d’interpeller le préfet du département sur des difficultés rencontrées afin d'améliorer les contrats de ville et de mieux répondre aux attentes des habitants.
Cette saisine fait l'objet d'une transmission au maire, au président d’EPCI et aux signataires du contrat de ville.
Lorsque la nature et l'importance des difficultés rencontrées le justifient, le préfet soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu'il préconise pour y remédier.
En vue de l'actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l'avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l'assemblée délibérante de l’EPCI ainsi qu'à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.
Maîtrise de la langue française tout au long de la vie (article 157)
Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs (article L.6111-2 du code du travail).
Dispositions relatives à la fonction publique
Rapport de lutte contre les discriminations (article 158)
Le gouvernement publie deux fois par an un rapport sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique
Ouverture de l’accès à la fonction publique (article 159)
Un troisième concours d’accès à la fonction publique (d’Etat, hospitalière et territoriale) est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice :
- d’un ou plusieurs mandats d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale,
- d’une ou plusieurs activités professionnelle ou associative en qualité de bénévole.
La durée d’exercice des activités requises est fixée pour chaque type de concours. Les durées du contrat d’apprentissage et du contrat de professionnalisation sont désormais décomptées dans le calcul de cette durée.
Recrutement dans les emplois par contrat de droit public (articles 160 à 162 et 167)
Emplois de catégorie C
Le PACTE (Parcours d'accès aux carrières des trois fonctions publiques) s'adresse aux jeunes de faible niveau de qualification. Il leur permet d'être recrutés sur des emplois de catégorie C dans la fonction publique. Il s’adresse aux jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus (avant âgés de 16 à 25 ans révolus) qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue.
Ce contrat leur permet d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi.
Les personnes en situation de chômage de longue durée, âgés de 45 et plus selon certaines conditions sont également concernées par cette mesure (article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Le nombre de postes ouverts par cette voie de recrutement ne peut être inférieur à 20 %.
Emplois de catégorie A et B
Le même recrutement peut s’opérer à titre dérogatoire pour une durée de 6 ans pour les emplois de catégories A et B
Un tuteur sera désigné pour accompagner les candidats dans leurs nouvelles activités.
Respect de la personne (article 165)
Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste qui pourrait porter atteinte à « sa dignité ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Présidence des jurys (article 166)
Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. Un décret fixe les conditions d'application de cette mesure.
Egalité entre les hommes et les femmes (articles 201 et 205)
Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont partagées entre les communes, les départements et les régions (article L.1111-4 du CGCT).
Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations
Circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie (article 171)
Les auteurs d’injures racistes ou discriminatoires seront plus sévèrement condamnés. Ils encourront non plus 6 mois d’emprisonnement et 22 500 euros d’amende, mais 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les auteurs de délits de provocation, de diffamation et d’injures racistes ou discriminatoires pourront être condamnés à une peine complémentaire de stage de citoyenneté.
Les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie sont généralisées à l’ensemble des crimes et délits.
La presse et les crimes de génocide et contre l’humanité (article 173)
Les sanctions contre les auteurs d’articles minorant les crimes contre l’humanité, les génocides et l’esclavage sont renforcées et précisées dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Communication audiovisuelle (article 182)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes de télévision ainsi qu’au respect de la dignité de toute personne et notamment des femmes.
Marchés publics (article 213)
Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations (article L. 2112-2 du code de la commande publique).
Formation de la Direction des ressources humaines des entreprises (article 214)
Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans.
Identification des potentiels d’embauche des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 215)
Le préfet de région, en concertation notamment avec les collectivités locales, identifie les possibilités de recrutement de ces jeunes par bassin d’emplois. Pôle emploi accompagne les entreprises dans ce recrutement.
Dispositions relatives à l’éducation
Inscription à la cantine dans les écoles primaire (article 186)
La loi précise que « l’inscription à la cantine scolaire est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ».
Stage de découverte professionnelle (articles 187 à 189)
Un pôle de stage dans chaque académie accompagne les élèves des classes de 3ème des collèges ainsi que les élèves des lycées professionnels dans la recherche de stages et veille à la non discrimination des stagiaires.
Les collèges et les lycées font connaître aux élèves les différents stages proposés dans les administrations et les collectivités territoriales. Les bénéficiaires de bourse peuvent, à leur demande, bénéficier de stage dans ces secteurs.
Dispositions relatives aux personnes sans domicile stable et a l’exercice d’activités ambulantes
Personnes et familles sans domicile stable (article 193)
Les termes de « sans domicile fixe » sont remplacés par les termes de « sans domicile stable » dans l’ensemble des codes traitant du sujet.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a élu son domicile (article L.264-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)).
Par dérogation au CASF, et pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune, et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du CCAS (centre communal d'action sociale) de cette commune ou du CIAS (centre intercommunal d'action sociale) dont dépend cette commune.
Elles sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune.
Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, son inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance (article L.131-2. du code de l’action sociale et des familles).
Activités ambulantes (articles 194 et 195)
Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret détermine les conditions d'application de cette mesure.
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.
L’Urbanisme
La loi comprend, comme d’habitude, son lot d’articles modifiant le code de l’urbanisme et notamment la partie de celui-ci consacrée à la planification.
Les évolutions liées à la loi portent sur deux domaines, dont les mesures concernant les communes et les établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de la Haute-Garonne vous sont détaillées ci-après.
En préalable, la loi égalité et citoyenneté supprime l’obligation, pour les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriaux (SCOT), de prendre en compte la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II » avant le 1er janvier 2017. Désormais, cette prise en compte devient obligatoire à la première révision du document.
Les mesures concernant les plans locaux d’urbanisme
- Le code de l’urbanisme (CU) prévoit que lorsque la compétence en matière de PLU et de cartes communales a été transférée à l’EPCI, l’élaboration d’un PLU correspondant à l’ensemble du territoire de l’EPCI, appelé PLU intercommunal (PLUi), est obligatoire dès que l’EPCI doit procéder à la révision du PLU d’une des communes membres.
La loi « égalité et citoyenneté » modifie cette règle lorsque l’EPCI est issu de la fusion d’EPCI qui étaient déjà compétents en PLU et d’EPCI qui ne l’étaient pas. Dans ce cas, il sera possible de procéder, pendant 5 ans à compter du transfert de compétences, à la révision des PLU des communes membres sans avoir à élaborer un PLUi. Cette mesure ne concerne, dans notre département, que la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges (5C).
De plus, la loi prévoit désormais que seule une révision due au changement des orientations définies par le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) entraîne l’obligation d’élaboration d’un PLUi par l’EPCI compétent.
- Lorsque la compétence PLU et carte communale a été transférée à un EPCI, celui-ci peut procéder à des évolutions des documents d’urbanisme communaux, sans avoir à réaliser de PLUi. Cette possibilité qui ne concernait, jusqu’au 28 janvier, que les modification, modification simplifiée et mise en compatibilité des PLU est étendue à la procédure de révision dite « allégée » de l’article L.153-34 du CU.
- La loi restreint la possibilité d’élaborer un PLUi tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH), aux seuls EPCI compétents en matière d’habitat.
- Le code de l’urbanisme permettait à la collectivité compétente dès la prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU, d’opposer un sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles de remettre en cause le projet de PLU ou d’en rendre l’exécution plus onéreuse. Dans les faits, une jurisprudence abondante ne permettait la mise en œuvre effective de ce sursis que lorsque les études étaient suffisamment avancées pour justifier de l’intérêt de la suspension de l’instruction. Dorénavant, le CU précise que le sursis à statuer ne peut être opposé aux demandes d’autorisation que lorsque le débat sur le PADD a eu lieu au sein du conseil municipal ou communautaire.
- L’article L.113-2 du CU est complété, pour préciser que les coupes et abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement, peuvent être soumis à déclaration préalable, pendant le temps d’élaboration ou de révision du PLU, dans la mesure où cette mesure est inscrite dans la délibération de prescription.
- La loi égalité et citoyenneté a pris en compte la spécificité des grandes intercommunalités (plus de 100 communes) issues de fusions, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe. En Haute-Garonne cette mesure ne concerne que la « 5C », compétente en matière de PLU et carte communale et qui compte 104 communes.
La loi offre à cet EPCI la possibilité d’élaborer à la place d’un PLUi couvrant l’ensemble du territoire, des PLUi infracommunautaires regroupant chacun plusieurs communes ou une commune nouvelle. Toutefois, l’ensemble de ces PLU doit couvrir la totalité du territoire.
Cette possibilité de dérogation à l’obligation d’élaborer un PLUi intégral doit être sollicitée par l’EPCI auprès du Préfet, par délibération du conseil communautaire, qui précise :
- Le périmètre de chaque PLU infracommunautaire ;
- Le calendrier prévisionnel des différentes procédures d’élaboration des PLU ;
- Le calendrier prévisionnel d’élaboration du SCOT, lorsque le territoire de l’EPCI n’est pas couvert par un SCOT approuvé.
Le préfet dispose de 2 mois pour donner son accord, après avoir vérifié que ce projet respecte les grands principes du développement durable en matière d’urbanisme, inscrits à l’article L.101-2 du CU et les éventuels projets d’intérêts généraux (PIG). Pendant le temps d’élaboration des PLU infracommunautaires, les documents communaux ou intercommunaux existants (PLU et carte communale) continuent à s’appliquer sur leur territoire et peuvent faire l’objet de procédures d’évolution, révision pour les cartes communales uniquement, révision « allégée », modification, modification simplifiée et mise compatibilité pour les PLU.
Les PLU infracommunautaires approuvés peuvent faire l’objet d’une révision sur leur périmètre initial, sans que cela couvre l’intégralité du territoire de l’EPCI et n’entraîne l’élaboration d’un PLUi intégral.
Par contre, un PLU infracommunautaire ne peut tenir lieu de PLH [ Concernant les PLH, le décret n° 2018-142 du 27 février 2018 portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes locaux de l’habitat et aux comités régionaux et conseils départementaux de l’habitat et de l’hébergement - ATD 280 )].
La dérogation accordée par le Préfet cesse de s’appliquer si le SCOT n’est pas achevé dans les 6 ans qui suivent son octroi.
Dans ce cas, les procédures d’évaluation des PLU en cours peuvent être achevées par l’EPCI, qui peut également mettre en œuvre toutes les procédures d’évolution des PLU et cartes communales existants, hors la révision des PLU, en l’attente de l’élaboration d’un PLUi intégral.
- La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 14 mars 2014, dite « ALUR » prévoyait que l’obligation de transformer un Plan d’occupation des sols (POS) en PLU avant le 27 mars 2017, ou de mettre un PLU en compatibilité avec un SCOT dans les 3 ans suivant son approbation, ne s’appliquait pas au PLUi dont l’élaboration était prescrite avant le 31 décembre 2015, le débat sur le PADD réalisé avant le 27 mars 2017 et l’approbation du document délibérée avant le 31 décembre 2019. La loi égalité et citoyenneté supprime toute notion de date pour l’obligation de débat sur le PADD.
-----------------------------------
Les mesures concernant les Schémas de Cohérence Territoriale
La loi officialise la possibilité pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), d’élaborer, de gérer et de faire évoluer un SCOT.
L’extension du périmètre du PETR ou du syndicat mixte compétent en matière d’élaboration et de gestion du SCOT à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs EPCI, vaut extension du périmètre du SCOT. Dans ce cas l’établissement public peut :
- Achever les procédures d’élaboration ou d’évolution du SCOT sur le périmètre initial, si le débat sur le PADD a eu lieu avant l’extension
- Réaliser des modifications ou mise en compatibilité du SCOT sur son périmètre initial.
L’établissement public chargé du SCOT prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de son application, soit 6 ans après son approbation, la révision ou la modification du SCOT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu.
La possibilité pour un EPCI d’élaborer un PLUi tenant lieu de SCOT, sur l’ensemble de son territoire, est supprimée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.