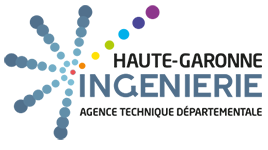L'apurement des titres de recettes
Dans le cadre de leurs activités, les collectivités locales sont amenées à percevoir des recettes de nature différentes, telles que des taxes ou redevances pour service rendu (redevance pour l'enlèvement des déchets ménagers, redevances d'eau et d'assainissement), des produits de ventes et prestations de services ou encore des produits domaniaux. Devant les difficultés parfois rencontrées pour procéder au recouvrement de certaines de ces recettes et notamment les loyers communaux, nous vous avions rappelé, dans ATD actualité du mois dernier, les règles générales régissant le recouvrement contentieux des recettes communales (n° 210 d'octobre).
Il peut arriver parfois que, pour diverses raisons, le recouvrement effectif de la recette communale ne puisse aboutir. Dans ce cas, il existe des pratiques budgétaires et comptables permettant de procéder à l'apurement du titre de recettes. Il s'agit de la réduction ou l'annulation du titre de recettes, de la remise gracieuse de la dette accordée par la collectivité ou de l'admission en non-valeur de la créance.
Cette fiche rappelle les particularités de chacune de ces procédures.
La réduction ou l'annulation du titre de recettes
Les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet :
- d'une part, de rectifier des erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronées) commises lors de l'émission du titre de recettes,
- d'autre part, de constater la décharge de l'obligation de payer prononcée, dans le cadre d'un contentieux relatif au bien-fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose jugée.
A cette fin, un titre rectificatif est établi par l'ordonnateur comportant les caractéristiques du titre de recettes rectifié et les motifs de la rectification.
Il y a lieu à réduction du titre de recettes lorsqu'une partie seulement du titre est affectée par l'erreur de liquidation, l'annulation étant opérée lorsque la créance constatée doit entièrement disparaître (titre établi à l'encontre d'une personne qui n'est pas le redevable ou titre faisant double emploi).
Le juge des comptes reste seul compétent pour apprécier la réalité de l'erreur invoquée par l'administration, quelle que soit la nature de l'acte administratif sur lequel le titre rectificatif est fondé.
Dans le cadre de leur contrôle, les comptables sont tenus, dans la limite des éléments dont ils disposent, notamment :
- de s'assurer que la réduction ou l'annulation d'un titre de recettes n'est opérée qu'aux fins de rectifier une erreur de liquidation ou d'exécuter un jugement ;
- de veiller à solliciter de l'ordonnateur l'émission d'un titre de réduction lorsque le comptable a connaissance d'une telle erreur ou décision de justice.
Au titre de ce contrôle, le comptable peut être amené à refuser la prise en charge, notamment dans les cas suivants :
- titre d'annulation/réduction d'un montant supérieur au titre initial ;
- absence de titre initial ou absence de référence au titre initial ;
- absence de(s) motif(s) de rectification ;
- absence de pièce justificative.
La remise gracieuse
La démarche de la remise gracieuse est fondée sur l'état de gêne du débiteur d'une créance régulièrement mise à sa charge, mettant ce dernier dans l'impossibilité de se libérer de tout ou partie de sa dette.
Dans ce cas, il peut présenter à la collectivité locale une demande de remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur (situation de ressources, charges de famille...).
Il appartient alors à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public local, en raison de sa compétence budgétaire, de se prononcer sur cette demande qu'elle peut rejeter ou admettre dans sa totalité ou partiellement.
La remise gracieuse intervient dans la phase amiable et exceptionnellement interrompt la phase contentieuse du recouvrement de la créance.
En tout état de cause, le débiteur ne peut solliciter une telle mesure que lorsque le titre de recettes a été émis à son encontre.
La remise de dette totale ou partielle fait disparaître le lien de droit existant entre la collectivité et son débiteur en éteignant la créance. Il en résulte par conséquent que la remise gracieuse libère définitivement le redevable et décharge de sa responsabilité personnelle et pécuniaire le comptable public.
Cependant, il convient de préciser qu'en raison même du principe de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice, une collectivité ou un établissement public local ne peut pas accorder la remise gracieuse de sommes mises à la charge d'un débiteur en vertu d'un jugement exécutoire.
L'admission en non-valeur
Dans le cas de l'admission en non-valeur, il s'agit de constater que les démarches accomplies pour recouvrer une créance n'ont pas abouti malgré les diligences de l'agent comptable.
Elle peut être demandée par le comptable et concerne :
- Les créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d'insolvabilité ou d'absence des débiteurs. Elle intervient donc après avoir épuisé toutes les possibilités : recours amiable, lettres de rappel, poursuites par voie d'huissier de justice, au vu d'un procès verbal de carence de l'huissier.
- Les créances pour lesquelles l'ordonnateur a refusé d'autoriser par écrit les poursuites en déchargeant ainsi le comptable de toute responsabilité (article 46 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 ). Dans ce cas, le comptable présente immédiatement en non-valeurs les créances concernées.
- Les créances ayant donnée lieu à l'échec du recouvrement amiable (créance inférieure aux seuils des poursuites définis au plan local).
Alors que la remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur, l'admission en non-valeur ne modifie pas les droits de l'organisme public vis-à-vis de son débiteur. En conséquence, l'admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.
La décision d'admission en non-valeur relève de la compétence de l'assemblée délibérante. Il s'agit d'une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître, des écritures du comptable, les créances irrécouvrables.
Contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s'il estime que l'irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences.
Inversement, le refus de la collectivité locale d'admettre en non-valeur une créance réellement irrécouvrable ne saurait empêcher le juge des comptes de décharger la responsabilité du comptable qui a effectué les diligences nécessaires ou qui n'a pu obtenir de l'ordonnateur l'autorisation de poursuivre le débiteur.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.