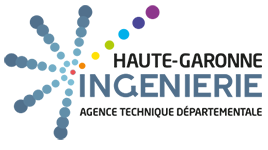Le retrait des délégations et ses effets
Pour diverses raisons, le maire peut décider de retirer les délégations qu’il a octroyées aux adjoints ou que ces derniers ne désirent plus assumer (article L.2122-18). Il en va de même pour le Président de l’EPCI.
La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a différencié les mécanismes de la délégation de fonction du maire et du Président. S’il y a donc des points communs dans ces procédures, les conséquences du retrait d’une délégation d’un adjoint sont désormais différentes de celles du retrait d’une délégation d’un vice-président.
Les étapes du retrait
La motivation du retrait
L’article L.2122-18 permet au maire seul chargé de l’administration d’attribuer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (article L.5211-2 pour l’EPCI). Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées (article L.2122-20).
Le maire dispose dès lors d’un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations ainsi distribuées.
Il n’est pas tenu de motiver formellement sa décision, ce qui signifie que les motifs de la décision du retrait n’ont pas à être formulés dans l’arrêté qui acte le retrait de délégation. Toutefois, il ne peut fonder cette décision sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. En effet le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration municipale (CE, 21 janvier 1990,n°95440).
Sa décision peut donc être motivée :
- Par une dissension grave entre le maire et l’adjoint (CAA Marseille, 8 octobre 2007, n° 06MA1709).
- Par des dissensions sur la question du personnel communal et la diffusion aux élus de la majorité d’un document mettant gravement en cause le maire (CAA Bordeaux, 3 décembre 2003, n° 99BX02860).
- Par les mauvaises relations entre le maire et l’adjoint après un vote défavorable de ce dernier sur le budget primitif et sur la gestion d’un service public communal (CAA Marseille, 5 juillet 2004, n°02MA00729).
En revanche, le retrait ne peut être motivé pour les raisons suivantes :
- Par un intérêt politique n’ayant aucun rapport avec le fonctionnement de la municipalité : la volonté de rééquilibrer la répartition des délégations en fonction des différents courants représentés au conseil municipal (CE, 20 mai 1994, n° 126958).
- Au motif que l’adjoint n’aurait pas exercé convenablement sa délégation pour avoir tardé à remettre un dossier relatif à un litige concernant des malfaçons affectant un bâtiment public, alors que l’intéressé expose, sans contestation de la part de la commune, avoir été victime de l’animosité du maire après qu’il l’eut informé de divers dysfonctionnements mettant en péril les finances de la ville (CAA Paris, 7 août 2002, n°98PA01545).
L’arrêté de retrait de délégation
La décision du maire prononçant le retrait d’une délégation prend la forme d’un arrêté municipal de la même manière que l’attribution d’une délégation.
Cet arrêté n’a pas à être motivé formellement car il n’a pas le caractère d’une sanction mais celui d’un acte règlementaire (CAA Marseille, 5 juillet 2004, n°02MA00729).
L’adjoint concerné, les conseillers municipaux et tout électeur peuvent intenter contre ce retrait un recours contentieux dans les conditions du recours pour excès de pouvoir prévues par le code de justice administrative. Le délai de recours est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée (article R.421-1 du code de justice administrative).
L’adjoint qui s’est vu retirer la délégation peut préférer, avant de former un recours contentieux, adresser au maire un recours gracieux sous la forme d’une réclamation lui demandant de revenir sur sa décision.
A la suite de cette réclamation, le maire peut la rejeter explicitement ou implicitement en gardant le silence. Le silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette réclamation vaut décision de rejet.
Les effets du retrait de délégation
Lorsque le maire a pris son arrêté et que ce dernier est entré en vigueur, l’adjoint ou le conseiller municipal perd :
- d’une part, les compétences et attributions que la délégation lui conférait,
- d’autre part, son droit à l’indemnité de fonction puisque celle-ci n’est versée que si la délégation est réellement effective (article L.2123-21). S’il continue à percevoir ses indemnités de fonction, le juge peut lui enjoindre de les reverser (CAA Marseille, 24 novembre 2003, n° 99MA00816).
Le rôle du conseil municipal en cas de retrait de la délégation d’un adjoint
Le conseil municipal doit se prononcer au scrutin secret sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions.
Le conseil municipal décide si l’adjoint conserve son titre et les fonctions qui y sont attachées (officier d’état civil et de police judiciaire), ou s’il les lui retire et ouvre donc la possibilité pour un conseiller municipal d’être élu adjoint sur le poste devenu vacant.
Deux possibilités :
- Le conseil municipal décide de ne pas maintenir l’adjoint dans ses fonctions.
Son poste d’adjoint devient vacant, l’élu en question reste simple conseiller municipal. L’adjoint qui n’a pas été maintenu dans ses fonctions n’a pas l’obligation de démissionner.
- Le conseil municipal décide de maintenir l’adjoint dans ses fonctions.
Dans ce cas, le retrait de délégations ne fait pas perdre à l’adjoint les compétences qui lui appartiennent en sa qualité d’adjoint. Ainsi, il conserve les attributions attribuées par les articles L.2122-31 et L.2122-32, soit les attributions exercées en tant qu’agent de l’Etat : officier de police judiciaire et officier d’état civil. Il peut également être désigné comme président d’un bureau de vote.
Précisons qu’en cas d’égalité des voix à l’issue du vote, la prépondérance de la voix du maire ne pouvant être prise en considération, la proposition de maintien de l’intéressé dans ses fonctions n’est pas adoptée (Rép. Min. n° 24210, JO Sénat 9 novembre 2006).
La modification de l’article L.2122-18 par la loi du 27 décembre 2019, dite loi engagement et proximité, a largement simplifié la situation liée au remplacement de l’adjoint et donc à l’octroi ou non des délégations à un adjoint remplaçant ou au maintien des délégations données aux conseillers municipaux. En effet, le principe de « priorité des adjoints » a été supprimé, laissant la possibilité pour le maire de donner des délégations aux conseillers municipaux même si tous les adjoints n’en détiennent pas.
Par conséquent, la décision du conseil municipal de maintenir un adjoint malgré le retrait de ses délégations n’implique pas, pour le maire, de devoir retirer l’ensemble des délégations attribuées aux conseillers municipaux. Ils peuvent les conserver. De plus, le maire peut aussi attribuer les délégations retirées à l’adjoint à un conseil municipal.
Le rôle du conseil communautaire en cas de retrait de la délégation d’un vice-président
Par renvoi de l’article L.5211-2, le conseil communautaire doit se prononcer au scrutin secret sur le maintien de l’adjoint dans ses fonctions.
En cas d’égalité des voix à l’issue du vote, la prépondérance de la voix du président ne pouvant être prise en considération, la proposition de maintien de l’intéressé dans ses fonctions n’est pas adoptée.
Le conseil communautaire décide si le vice-président conserve son titre et les fonctions qui y sont attachées, ou s’il les lui retire et ouvre donc la possibilité pour un membre du bureau d’être élu vice-président sur le poste devenu vacant.
Deux situations sont donc à envisager.
Le conseil communautaire décide de ne pas maintenir le vice-président dans ses fonctions
Son poste de vice-présidence devient vacant, l’élu en question reste simple conseiller communautaire. Il n’a pas été maintenu dans ses fonctions mais n’a pas l’obligation de démissionner.
Dans cette situation, il convient de distinguer deux cas :
- Le vice-président est démis de ses fonctions mais pas remplacé.
Le conseil communautaire « suit » l’avis du président et se prononce contre le maintien du vice-président dans ses fonctions. En effet le principe précité de « priorité des vice-présidents » ne joue plus, puisque tous les vice-présidents ont reçu délégation.
On considère alors que les vice-présidents en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées aux membres du bureau peuvent être maintenues.
- Le vice-président est démis de ses fonctions et remplacé.
Le conseil communautaire après avoir démis le vice-président de ses fonctions peut élire un vice-président pour le remplacer.
Dans ce cas, le président devra immédiatement prendre un arrêté afin de donner une délégation au nouvel élu, sauf s’il retire celles détenues par les autres membres du bureau, toujours dans le souci de respecter le principe de priorité des vice-présidents.
Le conseil communautaire décide de maintenir le vice-président dans ses fonctions
Dans cette situation, le président est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à d’autres membres du bureau, sauf à conférer au vice-président intéressé une nouvelle délégation.
Ainsi, le président est lié par la décision du conseil communautaire et se trouve dans une situation plutôt inconfortable :
- Un nouveau vice-président ne pourra être élu.
- Le président doit attribuer de nouvelles délégations au vice-président à qui il vient d’en retirer, s’il ne souhaite pas retirer les délégations confiées aux autres membres du bureau, afin de respecter le principe de priorité des vice-présidents.
Enfin, si le président décide de retirer les délégations aux membres du bureau, il assurera lui-même ces fonctions ou il les répartira entre les autres vice-présidents.
Complément de lecture
Le juge considère que le recours contre la délibération décidant le maintien de l’adjoint ou du vice-président dans ses fonctions est susceptible de recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois (article R.421-2 du code de justice administrative et CAA Douai, 19 janvier 2012, n° 11DA00493).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.