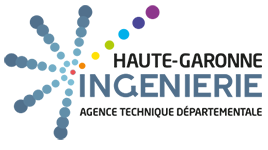La prévention des conflits d’intérêts
Deux lois parues à l’automne 2013 sont venues renforcer les dispositifs existants en matière de transparence de la vie publique en imposant de nouvelles obligations aux acteurs publics, qu’ils soient titulaires d’un mandat électif ou chargés d’une mission de service public (lois organique (n° 2013-906) et ordinaire (n° 2013-907) du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique).
Ces personnes doivent exercer « leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité », pour cela, elles doivent notamment veiller à « prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » (article 1er de la loi n° 2013-907).
Les élus locaux, tout comme les agents publics ou les délégataires de service public étant directement concernés par ces obligations, il a paru nécessaire de faire un point sur ces nouvelles règles qui ont déjà été rappelées lors des réunions cantonales qui se sont tenues d’octobre à décembre 2014.
Le conflit d’intérêts
La définition du conflit d’intérêts
Le conflit d’intérêts est défini par la loi n° 2013-907. Selon l’article 2 de ce texte, le conflit d’intérêts est constitué par « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
Le conflit d’intérêts peut exister sans que soit établie la recherche d’avantages indus, ni même la contradiction entre les intérêts en présence. Du seul constat d’une cohabitation des intérêts, et donc d’une apparence d’influence sur la décision prise, découle l’irrégularité.
Les personnes concernées
En application de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, le conflit d’intérêts concerne :
Les personnes titulaires d’un mandat électif local : sont à ce titre visés :
Les exécutifs locaux
- Présidents de conseils régionaux et généraux
- Maires, présidents d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, d’un syndicat mixte, d’un établissement public (ex. : centre communal d’action sociale).
Les autres élus locaux :
- Vice-présidents des régions et départements
- Conseillers régionaux et généraux
- Adjoints et conseillers municipaux
- Vice-présidents et membres du bureau d’un EPCI
- Conseillers communautaires, délégués communaux
- Autres vice-présidents et membres de l’organe délibérant d’un établissement public.
Les personnes chargées d’une mission de service public, c’est-à-dire :
- Les agents publics, qu’ils soient :
- Titulaires d’une délégation de signature
- Ou placés sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique.
Les personnes privées exerçant une activité de service public, comme les délégataires de service public.
Les obligations en cas de conflit d’intérêts
En cas de survenance d’une situation de conflit d’intérêts, l’intéressé devra se conformer aux obligations prévues par la loi n° 2013-907 et son décret d’application (décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014), lesquels organisent une obligation générale d’abstention d’agir ou de décider.
Les personnes titulaires d’un mandat électif local
Les exécutifs locaux : obligation de déléguer leurs fonctions (articles 2 de la loi et 5 du décret)
Lorsqu’un exécutif local estime se trouver en situation de conflit d’intérêts et qu’il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, l’intéressé doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner la personne chargée de le suppléer.
L’exécutif ne peut adresser aucune instruction à son délégataire.
Les élus titulaires d’une délégation de signature : obligation d’informer l’exécutif (articles 2 de la loi et 6 du décret)
Lorsqu’un élu local titulaire d’une délégation d’une délégation de signature estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il doit en informer l’exécutif (le délégant) par écrit, et préciser la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Le délégant doit ensuite prendre un arrêté afin de déterminer les questions pour lesquelles la personne intéressée devra s'abstenir d'exercer ses compétences.
Les élus qui ne sont pas titulaires d’une délégation : obligation de s’abstenir
L’élu doit en particulier s’abstenir de participer aux délibérations du conseil municipal ou à une commission de travail ayant trait à des questions ou affaires dans lesquelles il a un intérêt.
Les personnes chargées d’une mission de service public (articles 2 de la loi et 7 du décret)
Les agents publics : obligation d’informer et de s’abstenir
Un agent public titulaire d'une délégation de signature qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts doit informer sans délai le délégant par écrit, et préciser la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Il devra s'abstenir de donner des instructions aux personnes placées sous son autorité relativement à ces questions.
Un agent public placé sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, doit informer sans délai celui-ci par écrit, et préciser la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Les personnes chargées d’une mission de service public : obligation de s’abstenir
Les sanctions encourues pour les élus locaux
Les dispositions consacrées au conflit d’intérêts ont été mises en place pour prévenir les risques juridiques qui pourraient peser sur les élus concernés et sur la commune.
Le risque administratif pour la commune : l’annulation des délibérations
Un conseiller municipal qui se trouve en position de conflit d’intérêts et qui ne prend pas les mesures propres à remédier à cette situation, sera d’abord qualifié de « conseiller intéressé » s’il prend part au vote d’une affaire dans laquelle il a un intérêt.
Or, aux termes de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ».
Selon la jurisprudence, même si l’intérêt est établi, il faut encore, pour que l’illégalité soit déclarée, que la participation du conseiller municipal ait été de nature à exercer une influence sur le résultat du vote.
Tel est le cas lorsque l’élu intéressé participe aux débats ou au vote.
En outre, par une transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation consacrant le délit de prise illégale d’intérêt en raison de la simple présence d’un conseiller municipal à la séance du conseil municipal au cours de laquelle est évoquée l’affaire dans laquelle il a un intérêt (Cass. Crim., 19 mai 1999, n° 98-80726), il y a lieu de considérer qu’une délibération adoptée en pareilles circonstances serait également illégale.
Un risque pénal pour l’élu concerné : la requalification en délit de risque illégale d’intérêts
L’article 432-12 du code pénal prévoit que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».
Pour que le délit de prise illégale d’intérêts soit constitué, deux conditions doivent être réunies.
L’élu a pris, ou reçu, ou conservé quelque intérêt que ce soit dans l’opération
L’intérêt illégalement pris est interprété de manière très large par le juge pénal. Il peut être de nature matérielle, morale, familiale ou politique. Il peut être direct ou indirect.
Par exemple, une conseillère municipale qui participe à une délibération attribuant un marché de travaux à une entreprise dans laquelle elle exerce des pouvoirs en tant que secrétaire et comptable et en tant qu’épouse du dirigeant actionnaire, retire un intérêt direct de cette opération, et commet un délit de prise illégale d’intérêts (CA Toulouse, 7 octobre 1999).
Possède également un intérêt à l’opération en cause, l’adjoint qui avait émis un avis favorable à la reconduction d’une demande de subvention présentée par une association au sein de laquelle il avait une influence, par laquelle il avait été démarché dans le but de faire travailler pour le compte de celle-ci, une entreprise commerciale dont il assurait la direction ; peu importe qu’au moment du vote de la subvention, il n’existait pas encore de relations commerciales formalisées entre l’entreprise et l’association (Cass. Crim., 9 mars 2005, n° 04-83615).
Enfin, le juge considère que le délit est constitué alors même-même qu’il n’y a aucune recherche de gain ou de tout autre avantage personnel (Cass. Crim., 21 juin 2000 n° 99-86871 : à propos d’un maire ayant participé à l’attribution de marchés de travaux à des sociétés gérées par ses enfants).
L’élu doit avoir eu, au temps de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt
Une réponse ministérielle définit « la notion de surveillance ou d’administration d’une opération » comme « tout pouvoir de décision, total ou partiel, dévolu à une seule personne ou partagé entre plusieurs » (Rép. Min. n° 19933 du 20 octobre 2005, JO Sénat du 19 janvier 2006). Elle précise ainsi qu’un élu qui dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’opération dans laquelle il possède un intérêt, est exposé au délit de prise illégale d’intérêts.
La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que la « surveillance, au sens des articles 432-12 et 432-13 du code pénal, peut s'entendre de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ou même d'avis en vue de décisions prises par d'autres ; que de tels actes peuvent résulter de l'exercice d'un pouvoir de fait, y compris d'origine politique, sur les organes décisionnaires » (Cass. Crim., 27 juin 2012, n° 11-86920).
Dans le cas du maire, le délit est toujours constitué, alors même que, dans la matière incriminée, il aurait donné délégation à un adjoint (Cass. Crim., 9 février 2005, n° 03-85697).
La jurisprudence estime, en effet, que le maire étant chargé ès qualités de surveiller l'ensemble des opérations réalisées pour le compte de la commune (Cass. Crim., 23 février 1966, Brunel, Bull. crim. 1966, n° 64), il tombe sous le coup de l'incrimination, sans même avoir à rechercher son degré d'implication.
En revanche, pour les adjoints ou conseillers municipaux, le délit n’est constitué que s’ils ont vraiment le contrôle et l’administration de l’opération. Il en est ainsi :
- Lorsque l’élu intervient dans ses domaines de compétences propres ou déléguées et qui coïncident avec le domaine dont relève l’opération (Cass. Crim., 19 novembre 2003, n° 02-87336).
La forme de cette intervention peut recouvrir des modalités diverses et variées (instruction du dossier, prise d’une décision, rapporteur du conseil municipal par exemple).
- Ou lorsqu'il est titulaire de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres (Cass. Crim., 7 octobre 1976).
Tel est le cas, par exemple, lorsque l’élu est membre de la commission municipale dont relève l'opération.
- Ou enfin lorsque l’élu participe à la délibération relative à l’opération dans laquelle il possède un intérêt.
Le juge considère, en effet, que la participation d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal (Cass. Crim, 19 mai 1999, n° 98-80726).
La simple présence du conseiller municipal au sein de l’assemblée, au moment où l’affaire va être débattue, suffit à considérer que le conseiller a la surveillance de cette affaire. Il ne suffit donc pas, pour exclure le risque, que l’élu s’abstienne de voter la délibération, il faut également qu’il s’abstienne de participer à la discussion (Cass. Crim., 14 novembre 2007, n° 07-80220).
Cette sévérité de la jurisprudence pénale a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation confirmant la condamnation de plusieurs élus de la ville de Bagneux pour avoir participé et voté des délibérations attribuant des subventions à des associations qu’ils dirigeaient. Le juge précise qu’« il importe peu que ces élus n’en aient pas retiré un quelconque profit ou que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal » (Cass. Crim., 22 octobre 2008, n° 08-82068).
Pour éviter qu’un pouvoir de décision ne soit reconnu à un membre du conseil municipal (adjoint ou conseiller) dans une opération à laquelle il a un intérêt, l’élu ne doit pas :
- détenir une délégation de fonctions à laquelle se rattache l’opération en cause ;
- participer à l’instruction, au vote, décisions ou délibérations des commissions et assemblées qui concernent cette opération ;
- siéger effectivement à la séance du conseil lorsque les débats vont porter sur cette opération : l’élu doit donc quitter la salle et son départ doit être mentionné sur le procès-verbal de la séance.
Enfin, Il est important de souligner que les précautions prises par un élu qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts sont sans effet concernant le risque pénal auquel l’intéressé s’expose. En effet, déléguer ses fonctions selon la loi du 11 octobre 2013 ne suffit pas pour écarter la prise illégale d'intérêts.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.