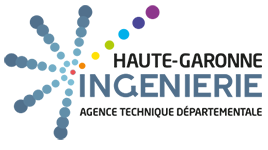Le personnel communal peut-il déjeuner gratuitement au restaurant scolaire ?
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) déjeunent fréquemment au sein du restaurant scolaire, avant le repas des enfants. Plus largement, la collectivité peut faire profiter le personnel communal de ce service public.
Quelle est la réglementation applicable à cette situation ? Cette gratuité constitue-t-elle un avantage en nature ? Cette pratique est-elle conforme à la légalité ?
La fourniture de repas à titre gratuit constitue-t-elle un avantage en nature ?
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter.
Il s'agit, le plus souvent, d'une prise en charge des frais de repas, de la fourniture d'un logement de fonction, de l'utilisation privée d'un véhicule ou encore de la mise à disposition d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (téléphones mobiles, ordinateurs...).
Ce sont les textes relatifs à l'assujettissement aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu qui permettent d'apprécier le contenu des avantages en nature dans la mesure où ces derniers ne font pas partie des éléments constitutifs de la rémunération des fonctionnaires tels qu'énumérés par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais sont assujettis aux cotisations sociales et entrent dans l'assiette du revenu imposable.
Concernant la fourniture de repas, la Direction de la sécurité sociale, dans une circulaire de 2002, précise que « la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations » pour en déduire que:
« Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis:
- aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec des personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique,
- dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention) ».
Sur la base de cette disposition, certaines communes considèrent que la fourniture de repas aux personnels de cantine et de service ne constitue pas un avantage en nature.
Cette analyse ne semble pas partagée par les juridictions financières.
Ainsi par exemple, la chambre régionale des comptes de la Réunion a noté, dans l'un de ses rapports, qu'accorder la gratuité des repas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), aux agents de restauration ainsi qu'au personnel communal en stage de formation, sans que cette prestation en nature soit assujettie à cotisations sociales et fiscales, constitue « une analyse contestable au regard de la jurisprudence ».
Cette juridiction souligne en effet que « la Cour de cassation a, sur ce point, une jurisprudence constante : la fourniture de repas gratuits s'analyse bien comme une prestation en nature et doit donner lieu à paiement de charges sociales et à déclaration auprès des services des impôts ».
Pour l'administration la tolérance qui permet ne pas considérer comme un avantage en nature la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service doit s'analyser comme ne visant que « le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas ». Elle en déduit donc que « le personnel de cantine et de service n'est pas visé par cette tolérance ».
A retenir:
En conséquence, au vu des dispositions précitées, il apparaît que la fourniture de repas aux agents spécialisés des écoles maternelles ainsi qu'aux agents techniques doit être considéré comme constituant pour ces derniers un avantage en nature soumis à cotisations sociales et fiscales. Il reste toutefois à s'interroger sur la légalité de la fourniture à titre gratuit de ces repas.
Quelle est la légalité de la fourniture gratuite de repas à des fonctionnaires territoriaux ?
Le fait, pour une collectivité locale, de fournir gracieusement des repas à certains de ses agents a tout d'abord été examiné par la jurisprudence au regard du principe de parité.
L'évolution de la législation relative aux prestations sociales des collectivités locales conduit toutefois à se demander si les aides au repas peuvent être encore soumises au principe de parité.
L'application du principe de parité entre fonctions publiques
Dans un arrêt de 2001 (n°204346, 29 juin 2001), le Conseil d'Etat a considéré que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allauch avait accordé au personnel communal devant déjeuner sur son lieu de travail par nécessité de service, un repas sur place gratuit, était illégale car « il est constant que les agents de l'Etat, soumis à des sujétions équivalentes à celles des agents de la commune d'Allauch...ne peuvent bénéficier de la fourniture à titre gracieux d'un repas ». Par cette décision le Conseil d'Etat confirmait la position prise par la cour administrative d'appel de Marseille (n°98MA00303, 8 décembre 1998) qui, dans la même affaire, avait rappelé que « les collectivités territoriales ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, qu'elles soient en nature ou qu'elles prennent la forme d'indemnités, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat, soumis à des sujétions équivalentes ».
On notera que, pour rendre leurs décisions, le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel se sont tous les deux fondés sur le principe de parité entre les fonctions publiques tel qu'il ressort des termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale selon lesquels « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat » et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application qui prévoit que « le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes ( ...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ».
C'est également sur la base de cette même législation (article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et article 1er du décret du 6 septembre 1991) qu'en 2006 la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a invité une collectivité qui fournissait annuellement environ 7 000 repas gratuits à ses agents municipaux à « prendre une délibération fixant l'avantage qu'elle entend ainsi attribuer à ceux des agents qui y ont droit, dans les limites des avantages accordés aux agents de l'Etat », la juridiction financière ayant au préalable constaté que « les agents de l'Etat ne peuvent bénéficier de repas gratuits, mais seulement d'une prestation-repas pour ceux dont l'indice est inférieur à un certain seuil ».
On notera toutefois qu'en 1999 le Ministère de la Fonction Publique faisait déjà le constat que « les conditions d'appréciation de la nature et des modalités d'attribution d'aide aux repas, selon les pratiques locales, demeurent parfois incertaines et ne sont pas sans se rattacher aux problèmes rencontrés en matière d'action sociale dans les collectivités locales » (QE n°15853, J.O Sénat 8 juillet 199).
Le contenu de cette réponse ministérielle invite à se demander si les décisions précitées ne doivent pas être mises en parallèle avec l'évolution qu'a suivi la législation relative aux prestations sociales des collectivités locales depuis l'adoption, en 1983, de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires.
L'évolution de la législation relative aux prestations d'action sociale des collectivités territoriales
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires faisait directement référence, dans sa version d'origine, aux prestations d'action sociale en précisant, dans son article 9, que « les fonctionnaires...participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ».
Cette disposition a été complétée une première fois en 2001 puis, plus récemment, en 2007.
En 2001 l'adoption de la loi relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique est venu préciser que « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ».
Quelques mois plus tard, l'administration, saisie par question parlementaire, répond qu'« il ressort de cet article que les prestations d'action sociale sont désormais définies comme distinctes de la rémunération, permettant ainsi d'éviter toute assimilation avec les régimes indemnitaires et son corollaire le principe de parité » (QE n°32690, J.O Sénat du 19 avril 2001).
Confronté à une disposition pour laquelle le législateur de 2001 ne s'était livré ni à une définition, ni à une énumération, le Conseil d'Etat est amené à préciser, dès 2003 (avis n°369315, 23 octobre 2003, Fondation Jean Moulin), les contours de l'action sociale en indiquant que cette dernière « regroupe l'ensemble des prestations destinées à améliorer directement ou indirectement les conditions d'emploi, de travail et de vie des agents et de leurs familles, notamment en les aidant à faire face à diverses situations difficiles» et, qu'au regard de cette définition, « relèvent de l'action sociale toutes les prestations versées, au cas par cas, après examen de la situation particulières des agents et qui sont, au demeurant d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées...Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'Etat ».
C'est manifestement sur la base de cet avis que le législateur intervient une deuxième fois en 2007 (article 26 de la loi n°2007-148) pour préciser, en des termes quasiment identiques à ceux employés par le Conseil d'Etat, que « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles » et que « sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale ».
Les conséquences de cette évolution pour l'application du principe de parité
Avant l'intervention de la loi du 3 janvier 2001 qui est venue préciser que les prestations d'action sociale étaient désormais distinctes de la rémunération, la jurisprudence du Conseil d'Etat considérait les aides au repas comme « un avantage financier indirect équivalent à un complément de salaire » et les soumettait au principe de parité. Ainsi par exemple avait été considérée comme illégale la délibération par laquelle un Conseil Général avait octroyé une subvention de 10 francs par repas quand l'avantage de même nature consenti par l'Etat à ses propres agents exerçant des fonctions équivalentes était limité à 5,05 francs par repas (Conseil d'Etat, n°136310, 21 octobre 1994, Département des Deux-Sèvres).
L'adoption de la loi précitée, complétée par celle de 2007 qui fait expressément entrer la restauration dans le domaine de l'action sociale laisse à penser que, désormais, les aides que peuvent apporter les collectivités locales à leurs agents en matière de restauration ne sont plus soumises au principe de parité.
C'est la conclusion à laquelle a abouti, par exemple, la cour administrative d'appel de Lyon dans une décision prise en 2007 (n°05LY00358, 18 décembre 2007, Département de la Côte-d'Or).
Après avoir rappelé que « les collectivités locales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques », la cour précise en effet que « ce principe ne s'applique pas aux prestations d'action sociale...qui sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ». En l'espèce « si la participation du département au financement des titres-restaurant représente pour les agents intéressés, un avantage financier indirect, elle est toutefois sans lien avec le grade, l'emploi ou de la manière de servir de ces agents ». Dès lors «elle ne constitue pas pour eux un élément de rémunération soumis au principe de parité entre les différentes fonctions publiques»..
A retenir:
Pour l'administration la tolérance qui consiste à ne pas considérer la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles comme un avantage en nature ne peut s'appliquer qu'au personnel « ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas ». Tel n'est pas le cas du personnel de cantine et, à fortiori, des agents techniques ou administratifs.
Le domaine de la restauration relève désormais de l'action sociale et n'est donc plus, de ce fait, soumis par la jurisprudence au principe de parité entre fonctions publiques.
L'aide que peuvent accorder les collectivités territoriales à leurs personnels en matière de restauration ne serait donc plus limitée par l'avantage de même nature consenti par l'Etat à ses propres agents.
Cette aide ne saurait toutefois aller jusqu'à consentir la gratuité des repas au personnel communal dans la mesure où le bénéfice de l'action sociale implique malgré tout, comme le prévoit désormais l'article 9 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, une participation du bénéficiaire à la dépense engagée.
Dès lors, la décision par laquelle un conseil municipal accorderait la gratuité des repas à une partie de son personnel pourrait être désormais jugée illégale non plus par application du principe de parité mais au regard de la disposition précitée.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.