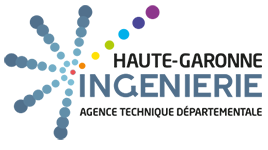Procédure de rupture du bail d’habitation d’un logement communal
Les possibilités offertes à la commune, en tant que bailleur, de rompre le contrat de location sont différentes selon qu’il s’agit d’une résiliation en cours de bail, par anticipation, ou d’une résiliation en fin de bail, autrement dit d’un non-renouvellement.
Cette Fiche technique détaille les procédures à mettre en œuvre dans chacun de ces cas.
Sur les modalités de rupture du bail en cours d’exécution
Un bail en cours d’exécution ne peut être rompu que dans deux hypothèses.
En cas de manquement aux obligations nées du contrat
Cette résiliation « pour faute » doit être demandée en justice. On parle alors de résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire est, pour l'essentiel, soumise aux règles de droit commun issues des articles 1227 et suivants du code civil.
La commune doit directement assigner son locataire, par acte d’huissier, devant le tribunal d’instance.
Avant d’engager toute action, le maire peut adresser à cette personne une mise en demeure de respecter ses engagements, mais il n’y est pas obligé. De même, la délivrance d’un commandement de payer préalablement à l'assignation n’est requise que pour l'application d'une clause résolutoire et non lorsqu'il est demandé au juge de prononcer la résiliation du bail (Cass. Civ. 3ème, 9 octobre 1996, Juris-Data n° 1996-003828 ; CA Paris 6ème ch. B, 25 juin 2000, Juris-Data n° 2000-115555).
Cette assignation aux fins de constat de résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur (article 24 II et III de la loi de 1989) ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides. Elle peut s'effectuer par voie électronique.
De plus, cette assignation doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
Ensuite, il appartiendra au juge d’apprécier si la faute du locataire concerné est d’une gravité suffisante, ou si elle cause un trouble ou un préjudice, pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
Par la mise en œuvre d’une clause résolutoire
Quatre motifs peuvent ainsi faire valablement l’objet d’une telle clause (article 4 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Il s’agit :
- du non-paiement du loyer et des charges,
- du non-paiement du dépôt de garantie,
- de la non-souscription d'une assurance des risques locatifs,
- du non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
La clause résolutoire ainsi prévue par le contrat de bail s’applique de plein droit, sans que les tribunaux ne puissent s'y opposer.
La mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, est subordonnée à l'accomplissement d'une formalité : le commandement de payer (article 24 de la loi de 1989).
Ce commandement est un acte d'huissier par lequel le locataire est informé de l'intention du bailleur de faire jouer la clause résolutoire. Le caractère d'ordre public de la loi interdit aux parties de convenir d'une autre forme de mise en demeure.
Le commandement de payer doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Ensuite, la clause résolutoire ne produira effet que si le locataire ne s'acquitte pas de ce dont il est redevable dans les deux mois suivant ce commandement et sous réserve que des délais de paiement ne lui aient pas été octroyés par le juge.
À l'issue du délai de deux mois suivant le commandement de payer (ou du délai de paiement accordé par le juge), faute pour le locataire de s’être acquitté de sa dette, le propriétaire peut saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et obtenir le titre exécutoire permettant de poursuivre l'expulsion. Il peut également le saisir en référé.
Tout comme dans le cas de la résiliation judiciaire, cette assignation :
- ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX ;
- doit être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au préfet (cf. supra).
Sur le non-renouvellement du bail
Quant à la motivation du congé
L’article 15 de la loi de 1989 limite la possibilité pour le bailleur personne morale, de donner congé, à l’expiration du bail, aux seuls cas :
- de vente du logement ;
- ou de l’existence d’un motif légitime et sérieux, « notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ».
|
Le comportement du locataire ou des travaux que la commune projette de réaliser, constituent-ils des motifs légitimes et sérieux de non-renouvellement du bail ? Le comportement agressif et violent d’un locataire pourrait, sous réserve de l’appréciation du juge, constituer un motif légitime et sérieux de non renouvellement du bail. Un tel comportement est considéré comme un abus de jouissance par le juge (Cass. Civ. 3ème, 8 novembre 1995, n° 93-10853 ; Ca Rennes, 4ème ch., 8 février 2001, n° 99/05513). En ce qui concerne la réalisation de travaux, le juge estime que ces derniers constituent un motif sérieux et légitime de non-renouvellent s’ils entraînent la reprise totale du bien et requièrent donc le départ du locataire : - Juris-Data n° 2005-574578 : travaux de réhabilitation et de mise en conformité de l'immeuble nécessitant de couper toutes les alimentations d'énergie, de gaz, d’électricité, les canalisations d'eau et d'évacuation (CA Aix-en-Provence, 11ème ch. B, 29 mars 2005). - travaux de rénovation lourde type démolitions intérieures, plomberie, électricité, menuiseries, plâtrerie, carrelage, peinture, ponçage des parquets (CA Bordeaux, 5ème ch., 2 juin 2009, Juris-Data n° 2009-377814). - travaux de réhabilitation de l'immeuble comportant la réfection totale de la toiture avec mise en place d'une charpente nouvelle ainsi que la réfection des plafonds sous toiture et la réfection du système d'assainissement non collectif (CA Montpellier, 1ère ch. D, 25 avril 2007 n° 06/03489, Juris-Data n° 2007-336186). La jurisprudence, fort abondante en la matière, a par ailleurs apporté les précisions suivantes : - les travaux n’ont pas à présenter un caractère indispensable : le juge considère en effet que le propriétaire est en droit de rechercher la rentabilité de son bien, en le rénovant intégralement (CA Bordeaux, 5ème ch., 6 novembre 2007, Juris-Data n° 2007-357411) ; - le bailleur doit prouver son intention réelle d'exécuter les travaux afin de permettre au tribunal d'apprécier leur ampleur et leur portée ; s'il n'est pas tenu de décrire en détail dans le congé les travaux projetés, il doit être en mesure de rapporter la preuve, par des documents précis (plans, permis de construire et de démolir, décision d'assemblée générale autorisant les travaux....) de la réalité de ses intentions.
|
Quant à la forme du congé
Il convient au préalable de rappeler que la commune ne peut donner congé à son locataire si celui-ci est âgé de plus de soixante cinq ans et si ses ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, si elle ne lui propose pas un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Ce logement doit être situé sur le territoire de la commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km (articles 15-III de la loi de 1989 et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948).
Ceci étant dit, pour être valable, le congé doit être délivré dans les conditions définies par l’article 15 de la loi de 1989. A défaut, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé (article 10 de la loi de 1989).
Ainsi, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué pour ne pas renouveler le bail. Le délai de préavis est de six mois (article 15 de la loi de 1989).
Le congé doit être notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
De plus, le bailleur doit joindre au congé une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. Un arrêté du 13 décembre 2017 détermine le contenu de cette notice.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.