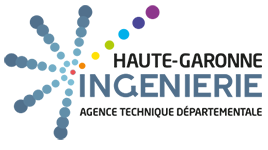La création d'une société publique locale
Les sociétés publiques locales (SPL) constituent une nouvelle forme de coopération intercommunale à laquelle le projet de schéma de départemental de la coopération intercommunale (SDCI) propose de recourir subséquemment à la dissolution d'un syndicat de communes.
Créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010, les SPL sont en effet venues enrichir la gamme des outils des collectivités territoriales au service des politiques locales, qui ne comprenait, jusqu'alors, que les sociétés d'économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA).
Le régime juridique des SPL est pendant longtemps resté imprécis. Une circulaire du 29 avril dernier est venue lever le voile et a ainsi apporté des éclaircissements aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui souhaiteraient mettre en place ce type de structure.
L'objectif de cette fiche technique est de vous présenter les principales caractéristiques de ces SPL.
Régime juridique
Une société publique locale (SPL) est une société anonyme créée par au minimum deux collectivités territoriales dont elles détiennent la totalité du capital afin de lui confier, sans mise en concurrence, des opérations d'aménagement, des opérations de constructions, l'exploitation de services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) ou toutes autres activités d'intérêt général.
Cette société exerce son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en sont membres.
En sa qualité de société anonyme, une SPL est régie par les dispositions du code du commerce (Livre II). Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT – titre II livre V de la première partie) lui sont également applicables.
Différences entre une SPL et une société d'économie mixte
D'abord, à la différence d'une société d'économie mixte (SEM), une SPL n'est créée que par des collectivités territoriales et pour ne satisfaire que leurs besoins: aucun actionnaire privé ne peut donc entrer dans le capital d'une SPL et celle-ci ne peut œuvrer que pour les collectivités actionnaires.
Ensuite, une SPL n'est pas mise en concurrence pour l'attribution de ses contrats liés à son objet statutaire. Les collectivités attribuent directement leurs services à la SPL dont elles sont actionnaires alors que les SEM doivent se soumettre à une procédure de mise en concurrence.
Différences entre une SPL et une régie
Si ces deux structures sont en théorie différentes, on peut néanmoins relever certaines similitudes.
La SPL est une société anonyme qui fonctionne comme une société de droit privé, avec une comptabilité de droit privé alors que ses actionnaires sont tous des collectivités publiques. La régie, quant à elle, fonctionne avec une comptabilité publique.
La SPL doit, en outre, être créée par au moins deux collectivités territoriales (ou leurs groupements) alors que la régie ne peut être créée que par une seule collectivité (ou un groupement).
Qu'il s'agisse d'une SPL ou d'une régie, il n'y a pas de différence pour le personnel qui relève, sauf exception, du droit privé (Dans une régie créée sous forme d'établissement public industriel et commercial (EPIC), le directeur et l'agent comptable, si celui-ci est comptable public, relèvent du droit public).
Une régie et une SPL ont par ailleurs toutes deux la possibilité de se voir confier directement, sans mise en concurrence, l'exploitation d'un SPIC.
Modalités de création d'une SPL
D'un point de vue pratique, les collectivités territoriales qui souhaitent créer une SPL doivent se mettre d'accord sur l'objet de la société, la répartition du capital et des sièges, et prendre chacune une délibération en ce sens.
Les collectivités actionnaires créent ensuite la SPL selon la procédure du code de commerce applicable aux sociétés anonymes (signature et publication des statuts dans un journal d'annonces légales, immatriculation de la SPL au registre du commerce et des sociétés (RCS) et enregistrement de statuts auprès des services fiscaux).
Enfin, chaque collectivité actionnaire conclut un contrat d'exploitation avec la SPL portant sur les services qu'elle entend lui confier, sans procéder à une mise en concurrence.
Fonctionnement
Règles de gouvernance entre les collectivités actionnaires
La SPL est doté d'un organe de gouvernance ; il peut s'agir soit d'un conseil d'administration (articles L.225-17 et suivants du code de commerce), soit d'un conseil de surveillance (articles L.225-57 et suivants du code de commerce).
Selon l'article L.1524-5 du CGCT, chaque collectivité (ou groupement de collectivités) actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
Les sièges sont attribués proportionnellement au capital détenu par chaque actionnaire.
Le code de commerce fixe entre 3 et 18 le nombre de membres au conseil d'administration ou au conseil de surveillance (articles L.225-17 et L.225-69 du code de commerce).
Champ d'intervention
Aux termes de l'article L.1531-1 alinéa 2 du CGCT, « ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général ».
Si le champ d'intervention d'une SPL est très large, il n'en reste pas moins encadré par les règles qui régissent les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements. En effet, si les collectivités et leurs groupements peuvent créer une SPL dans des secteurs variés, ils ne peuvent le faire que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi et sur leurs seuls territoires.
Rappelons que parmi les compétences des collectivités territoriales, compétences qui doivent toujours être justifiées par un intérêt public local, certaines sont expressément déterminées par le législateur, d'autres relèvent de l'application de la clause générale de compétence (article L.2121-29 du CGCT pour les communes).
Moyens d'action d'une SPL
Le capital
En application de l'article L.1531-1 du CGCT, le capital de la SPL est détenu en totalité par les collectivités (ou groupements) actionnaires. La loi n'impose pas qu'une collectivité détienne la majorité du capital.
En sa qualité de société anonyme, une SPL répond aux règles de droit commun définies par le code de commerce. Le capital est divisé en actions et constitué entre les associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Selon l'article L.224-2 du code de commerce, le capital social d'une SPL doit être égal à 37.000 € au moins. Toutefois, la SPL étant également soumise aux dispositions du CGCT, les seuils dérogatoires prévus pour les SEM locales d'aménagement et de construction, compte tenu de leur spécificité et de l'importance financière de leurs opérations, leur sont applicables. Ainsi, en se référant à l'article L.1522-3 du CGCT:
le capital social d'une SPL ayant dans son objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, doit être au moins égal à 225.000 € ;
le capital social d'une SPL ayant dans son objet l'aménagement, doit être au moins égal à 150.000 €.
Enfin, lorsque l'objet social de la SPL comporte à la fois des activités d'aménagement et de construction, ces montants minimum ne se cumulent pas. Le capital social doit alors être au moins de 225.000 €.
Le personnel
Le personnel d'une SPL relève en principe du statut de droit privé. Toutefois, il est possible que cette société fasse appel à des fonctionnaires territoriaux.
S'agissant des agents titulaires: il est possible d'envisager leur détachement en application de l'article 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Le détachement ne peut intervenir que sur demande du fonctionnaire, après saisine de la commission administrative paritaire (CAP). Seuls les titulaires d'un grade de la fonction publique territoriale peuvent en bénéficier, les fonctionnaires stagiaires en étant exclus.
Le détachement ne peut excéder une durée de cinq ans. Durant cette période, l'agent continue à bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite relatifs à ce cadre d'emplois.
Le fonctionnaire peut également être mis à disposition (article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée). Dans ce cas, l'agent, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
En ce qui concerne les agents contractuels: ils peuvent également faire l'objet d'un détachement conformément à l'article L.8241-2 du code du travail. Ce détachement impliquera une modification du contrat de travail devant faire l'objet d'un avenant (modification du lieu de travail, etc.).
Il est également possible de mettre fin amiablement au contrat et de proposer un nouveau contrat. La SPL sera alors l'employeur
Les contrats passés par la SPL
Une SPL est, en principe, soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application (n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).
Une SPL a également la possibilité de se soumettre volontairement au code des marchés publics en lieu et place de l'ordonnance (article 3 de l'ordonnance).
Cela étant, il convient de signaler qu'une SPL est tenue de respecter les règles du code des marchés publics quand elle agit dans le cadre d'un mandat tel que prévu par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP). En effet, agissant au nom et pour le compte d'une des collectivités (ou groupement) actionnaire, elle est alors soumise aux règles applicables à cette personne, c'est-à-dire au code des marchés publics.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.