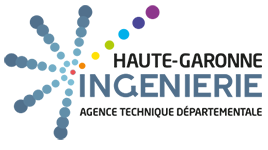Comment mutualiser les achats ?
Les collectivités disposent de deux moyens pour mettre en œuvre en commun des procédures de marchés publics :
- la constitution d’un groupement de commandes,
- la mutualisation des services.
La constitution d’un groupement de commandes
La création du groupement de commandes
L'article 8 du code des marchés publics (CMP) autorise la constitution de groupements de commandes entre personnes publiques à trois conditions :
- le coordonnateur du groupement doit avoir la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés public ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 ;
- la procédure doit respecter les règles prévues par le code des marchés publics ;
- chaque membre du groupement doit signer, avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses propres besoins.
Le groupement est créé par convention. Celle-ci doit être approuvée par une délibération de l'assemblée délibérante qui doit autoriser l'exécutif à la signer. Elle doit, enfin, être transmise au contrôle de légalité pour être exécutoire.
Selon une réponse ministérielle[1], la délibération déléguant au maire pour la durée du mandat toute décision concernant la préparation, la passation et l’exécution des marchés publics, en application de l’article L.2122-22 4° du CGCT, n’englobe pas l’autorisation donnée à l’exécutif pour la signature d’une convention constituant un groupement de commandes.
La convention constitutive du groupement est signée par tous les membres et indique les responsabilités et le degré de participation de chacun.
Elle contient au moins les clauses minimales suivantes : objet du marché, désignation des membres, répartition des dépenses, étendue des missions du coordonnateur, modalités de fonctionnement, définition de l'autorité compétente pour attribuer le marché, adhésion et sortie, durée du groupement (Modèle de convention en annexe 1).
Le fonctionnement du groupement de commandes
Les membres du groupement choisissent l’un d’entre eux comme coordonnateur et le mandatent pour agir en leur nom et pour leur compte.
L’article 8 précité du CMP prévoit trois degrés d’intégration du groupement. Le modèle adaptable proposé en annexe n° 1 permet l’application de chacun d’entre eux.
Le premier degré repose sur l’autonomie des membres du groupement (article 8VI):
Selon ce premier degré d’intégration, le coordonnateur prépare le marché et mène la procédure de passation. Ensuite, chaque collectivité signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l’attributaire commun, lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne exécution (un acte d’engagement par membre). Dans le cadre d’un marché à bons de commandes tel que défini à l’article 77 du CMP, les bons sont donc émis par les membres du groupement, car il s’agit de l’exécution du marché.
En procédure formalisée, l'autorité compétente pour attribuer le marché est la commission d’appel d’offres (CAO) du groupement qui revêt un caractère mixte : elle est composée d’un représentant de la CAO de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres à voix délibérative.
En procédure adaptée, la décision d'attribution du marché appartient à chaque assemblée délibérante sauf lorsque l’exécutif bénéficie d’une délégation - réponse ministérielle n°10929 ; JO Sénat du 21 novembre 2010 p. 131.
Le deuxième degré prévoit une intégration partielle du groupement (article 8 VII 1°) :
Dans ce second degré, la mission du coordonnateur consiste, au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement, à signer et à notifier le marché (acte d’engagement commun à l’ensemble des membres), chaque membre du groupement en assurant l’exécution.
Là aussi, dans le cadre d’un marché à bons de commandes, les bons sont émis par les membres du groupement.
La CAO compétente peut être, soit celle du coordonnateur, soit la CAO mixte. En procédure adaptée, l'organe compétent est l'assemblée délibérante du coordonnateur sauf là encore en cas de délégation à son exécutif.
Le troisième degré prévoit une intégration maximale du groupement (article 8 VII 2°) :
Dans ce degré le plus élevé, le coordonnateur est chargé de signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement. Dans le cadre d’un marché à bons de commande, c’est donc lui qui émet les bons.
Comme dans le cas précédent, la CAO compétente peut être soit celle du coordonnateur, soit la CAO mixte et en procédure adaptée, l'organe compétent est l'assemblée délibérante du coordonnateur sauf en cas de délégation à son exécutif.
L’annexe n°2 récapitule la répartition des compétences dans un groupement de commandes, pour chacun des trois degrés sus exposés.
La mutualisation des services
La création d’un service commun des marchés publics entre une communauté de communes et ses communes membres
Selon l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM, les communautés de communes peuvent créer, en dehors de leurs compétences statutaires, des services communs exerçant des missions aussi bien fonctionnelles qu’opérationnelles et concourant à l’exercice des compétences communautaires et communales.
Les missions fonctionnelles sont limitativement énumérées par la loi : gestion du personnel (à l’exception des missions assumées par les centres de gestion pour les collectivités obligatoirement affiliées), gestion administrative et financière, informatique, expertise juridique, expertise fonctionnelle et instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat. Les services des marchés publics se rattachent à la gestion administrative et sont donc « mutualisables ».
Les services communs sont gérés par la communauté de communes. Ils sont constitués par le regroupement des services intercommunaux et des services communaux, lorsqu’ils existent. A cet effet :
- Les fonctionnaires et les agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la communauté de communes, après avis de la commission administrative paritaire.
- Les fonctionnaires et les agents non titulaires communaux qui remplissent partiellementleurs fonctions dans un service ou une parte de service mis en commun sont mis, selon le cas, à la disposition de la commune ou de la communauté de communes pour l’exercice des missions relevant du service commun dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale (accord de l’intéressé et avis de la commission technique).
En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du maire. Ces derniers peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Contrairement au cas précédent du groupement de commandes, chaque collectivité reste compétente pour la préparation, la passation, et l’exécution du marché. Seul le service fonctionnel est mutualisé, mais pas la procédure d’achat. Afin de permettre un regroupement complet de la procédure d’achat, il est néanmoins possible de combiner les deux formules, à savoir la constitution d’un groupement de commandes et la mutualisation des services des marchés publics.
Les modalités financières
Selon le quatrième alinéa de l’article L.5211-4-2, une convention institue des règles d’utilisation du service commun par chaque collectivité et prévoit le remboursement, par chaque commune bénéficiaire de la mise à disposition, des frais de fonctionnement du service.
L’Assemblée des Communautés de France (ADCF) propose sur demande un modèle de convention de mutualisation des services.
Cette convention doit être accompagnée d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents.
Elle détermine par ailleurs le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
Elle est soumise à l'avis du ou des comités techniques compétents.
Enfin, pour les communautés de communes à fiscalité unique, les effets de la création d'un service commun peut être imputés sur l'attribution de compensation. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale prend en compte cette imputa
[1] Réponse ministérielle n° 1560, JO Assemblée Nationale, le 28 août 2012, p. 4837
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.