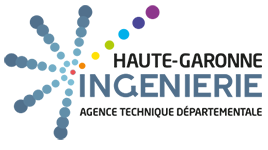Organisation et fonctionnement des EPCI fusionnés : les délibérations à prendre
L’organisation et le fonctionnement des établissements publics fusionnés au 1er janvier 2017 se mettent en place petit à petit. Les premières délibérations liées à l’installation de l’assemblée ont été prises, d’autres doivent être votées désormais.
Cet article liste les principales décisions à prendre.
L’adoption du règlement intérieur
Dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus, l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (articles L.5211-1 alinéa 2 et L.2121-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Le contenu du règlement
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par l’assemblée qui peut se doter de règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutefois, si l’assemblée dispose, en la matière, d’une large autonomie, le CGCT, complété par la jurisprudence, lui imposent de fixer dans son règlement intérieur :
- Les conditions d’organisation du débat d’orientations budgétaires (article L.2312-1).
- Les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés (article L.2121-12).
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.2121-19).
- Les modalités d’exercice du droit d’expression des élus minoritaires dans le bulletin municipal (article L.2121-27-1).
- Les modalités de présentation des comptes-rendus et des procès-verbaux des séances (CE, 18 novembre 1987, n° 75312).
- L’autorisation délivrée à l’exécutif de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération (CE, 10 février 1995, n° 147378).
En sus de ces mentions obligatoires, le règlement intérieur peut comporter des dispositions concernant notamment :
- La tenue des séances : à ce titre, peuvent être précisées les conditions dans lesquelles :
- le public ou la presse peut assister aux séances ;
- les conseillers peuvent prendre la parole ;
- les fonctionnaires intercommunaux peuvent assister aux séances et intervenir dans le cours du débat.
- L’organisation des débats : pour l’examen de chaque affaire soumise à délibération, le règlement intérieur peut définir une procédure de présentation et de discussion :
- résumé oral du dossier ;
- limitation du temps de parole de chaque intervenant.
- L’organisation interne de l’assemblée délibérante : dans ce cadre, le règlement intérieur peut définir la composition et le rôle des commissions chargées d’étudier les dossiers avant leur inscription à l’ordre du jour. Il peut en préciser :
- - les pouvoirs (uniquement consultatifs) ;
- - les règles de fonctionnement interne ;
- - les modalités selon lesquelles elles rendent leurs avis.
Portée juridique et contrôle du règlement
Le règlement s’impose en premier lieu aux membres de l’assemblée, les conseillers comme le président. Il s’ajoute au « bloc de légalité » (lois et règlements) que chaque délibération doit respecter.
Par voie de conséquence, la méconnaissance d’un article du règlement intérieur constitue une irrégularité substantielle qui entraîne l’illégalité de la délibération (CAA Versailles, 6 juillet 2006, n° 05VE01393).
Le législateur a prévu un contrôle sur la légalité des dispositions du règlement intérieur puisque l’article L.2121-8 alinéa 2 indique que ce document peut être déféré devant le tribunal administratif. Tel est le cas lorsqu’il contient des dispositions contraires à la loi.
La délibération adoptant ou modifiant le règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE Sect., 10 février 1995, n° 129168 ; CE, 10 février 1995, n° 147378).
Les dispositions du règlement intérieur ne forment pas un ensemble indivisible. Dès lors, est recevable la requête tendant à l’annulation partielle de certaines dispositions (CE n° 147378 susvisé).
La délégation de l’assemblée délibérante au bureau et au président
Afin de faciliter le fonctionnement interne des EPCI, l’article L.5211-10 du CGCT autorise l’organe délibérant à déléguer une partie de ses attributions
Le président peut ainsi bénéficier d’une délégation. Ces attributions peuvent d’ailleurs être subdéléguées par le président au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service, sauf si l’organe délibérant en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président.
Les vice-présidents peuvent également recevoir délégation de l’organe délibérant, sous réserve qu’ils soient par ailleurs bénéficiaires d’une délégation de fonction de la part du Président en vertu de l’article L.5211-9.
Enfin, le bureau dans son ensemble (composé de manière collégiale du président, du ou des vice-présidents et d’éventuels autres membres) peut être délégataire de l’organe délibérant.
L’organe délibérant peut donc décider d'accorder certaines délégations au président, d'autres aux vice-présidents ayant reçu délégation et d'autres encore au bureau, statuant de manière collégiale. En revanche, une même délégation ne peut être donnée concurremment à ces différentes autorités.
L’étendue de la délégation
L'article L.5211-10 du CGCT autorise l’organe délibérant à déléguer librement ses attributions dans toutes les matières autres que les sept qui y sont fixées.
Si les dispositions de l’article L.2122-22 du CGCT qui énumère très précisément les attributions qui peuvent être déléguées par le conseil municipal au maire peuvent éventuellement servir de référence, les organes délibérants des EPCI peuvent aller au-delà de ce qui est autorisé pour le conseil municipal, dès lors que les délégations ne portent pas sur les attributions suivantes relevant exclusivement des assemblées délibérantes :
1° le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° l'approbation du compte administratif ;
3° les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ;
4° les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° la délégation de la gestion d'un service public ;
7° les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Outre ces matières, il apparaît également prudent d’y inclure les domaines pour lesquels une disposition législative prévoit expressément la compétence de l’organe délibérant : ils devraient également être exclusifs de toute délégation. C’est ainsi que le juge administratif a refusé que le conseil communautaire délègue ses attributions au bureau en matière de versement de fonds de concours (CAA Nantes 27 mai 2011, n° 10NT01822).
Enfin, outre le respect des matières exclues, l’organe délibérant doit définir avec précision les domaines délégués : il ne peut simplement indiquer qu’il délègue “une partie de ses attributions” sans préciser lesquelles (CE, 2 février 2000, n° 117920).
Le régime de la délégation
L’organe délibérant procède aux délégations par délibération : il est libre de les accorder ou de les refuser ; il peut également les accorder en une ou plusieurs fois par délibérations successives.
La délégation est consentie pour la durée du mandat.
Cependant, l’assemblée délibérante conserve toujours le pouvoir de mettre fin aux délégations avant le terme du mandat si la bonne administration de l’établissement le commande.
Les délégations s’éteignent également en cas de décès ou de démission du délégataire. De nouvelles délégations ne pourront être accordées que si l’organe délibérant le décide par une nouvelle délibération.
La subdélégation des attributions déléguées par le conseil au président est possible, mais seulement au profit des vice-présidents ayant reçu délégation de fonction du président dans les matières déléguées (Réponse ministérielle n 01237, JO Sénat du 25 octobre 2007). Le président conserve cependant la pleine responsabilité de l’exercice des attributions subdéléguées.
En vertu de l’article L.2122-23 du CGCT, applicable aux EPCI par renvoi de l’article L.5211-2 du même code, les décisions prises par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils portant sur les mêmes objets, soit les règles relatives :
- à l’inscription au registre des délibérations,
- à la transmission au préfet des délibérations,
- à la publicité et à la notification des décisions,
- à l’exécution des délibérations,
- aux différents recours contentieux.
Enfin, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président est tenu de rendre compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant (article L.5211-10 du CGCT).
La désignation des membres de la commission d’appel d’offres
La composition de la CAO est alignée sur celle de la commission de délégation de service public.
Ainsi, la commission est présidée par l'autorité habilitée à signer le marché ou son représentant. Elle est complétée par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (articles L.1414-2 et L.1411-5 du CGCT).
Elle est réunie pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (article L. 2124-1du code de la commande publique).
La désignation des membres de la commission de délégation de service public
Cette commission intervient à l’occasion de l’ouverture des plis pour les délégations de services publics (article L.1411-5 du CGCT).
Les règles de composition de cette instance sont identiques à celles de la CAO pour ce qui concerne ses membres à voix délibérative.
La désignation des membres la commission consultative des services publics locaux
Les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par délégation ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.
Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 habitants et 50 000 habitants peuvent créer une telle commission dans les mêmes conditions (article L.1413-1 du CGCT).
Elle comprend des membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante.
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La désignation des membres de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
L’article L.2143-3 du CGCT prévoit l’obligation de créer cette commission pour les EPCI compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. La commission est présidée par le président de l’EPCI
Les missions de la commission intercommunale sont les mêmes que celles de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, mais elles sont exercées dans la limite des compétences transférées au groupement.
Les communes membres de l’EPCI peuvent également, grâce à une convention signée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’EPCI.
Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales doivent veiller à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Des communes peuvent également librement créer une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un EPCI.
Cette commission est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
La désignation de représentants au sein d’organismes extérieurs
Pour la désignation des représentants dans les organismes où l’EPCI est représenté, sauf cas particuliers, il convient de se reporter, au cas par cas, aux règles de fonctionnement propres à chacun des organismes concernés.
Le renouvellement du mandat des membres élus et nommés dans les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) est prévu par l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ainsi, les membres sont élus à la représentation proportionnelle par l’organe délibérant de l’EPCI et les membres nommés par le président de l’EPCI le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil et pour la durée du mandat de ce conseil.
Les articles L.6143-5 et R.6143-1 et suivants du code de la santé publique fixent la composition des conseils de surveillance des centres hospitaliers et hôpitaux locaux ayant le caractère d’établissements publics de santé « locaux » et les conditions dans lesquelles sont appelés à siéger des représentants élus par les assemblées locales.
Les articles L.315-10, L.315-11 et R.315-6 et suivants du CASF fixent la composition des conseils d’administration des établissements publics sociaux et médicosociaux créés par délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements et les conditions dans lesquelles sont appelés à siéger des représentants élus par les assemblées locales.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.