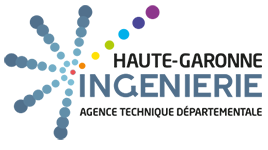La dissolution d'un syndicat de communes
Le droit commun de l'intercommunalité, inscrit dans le code général des collectivités territoriales, précise les cas dans lesquels la dissolution d'un syndicat de communes peut intervenir ainsi que la procédure et les conséquences juridiques, financières et patrimoniales qui s'y rattachent. Il existe cependant une procédure dérogatoire de dissolution prévue par la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme territoriale qui est initiée par le Préfet dans le cadre des pouvoirs exceptionnels et temporaires qu'il possède jusqu'au 1er juin 2013 pour la mise en œuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale (consulter l'article sur les pouvoirs de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI)). Cette procédure dérogatoire mérite une attention particulière car sa mise en application doit permettre la dissolution de plus de 2/3 de syndicats de communes en Haute- Garonne.
La dissolution d'un syndicat de communes a pour conséquence essentielle de restituer aux communes membres l'ensemble des compétences et des moyens qu'elles lui avaient transférés. A noter qu'elles peuvent aussi simultanément transférer leurs compétences retrouvées à une communauté de communes ou mettre en place d'autres instruments de coopération intercommunale. Ces cas de figure font l'objet des fiches techniques spécifiques:
- la reprise des compétences syndicales par une communauté de communes
- la création d'une entente intercommunale
Les cas de dissolution
L'article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui constitue le droit commun, prévoit quatre cas de dissolution d'un syndicat de communes:
- soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des services en vue desquels il avait été institué ;
- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés ;
- soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
- soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
En dehors de ce dispositif de droit commun, l'article 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit un dispositif dérogatoire et temporaire qui permet au Préfet, dès la publication du schéma, de proposer, jusqu'au 31 décembre 2012, la dissolution des syndicats de communes visés par le schéma. A cet effet, il notifie simultanément au Président du syndicat de communes afin de recueillir l'avis du comité syndical et au maire des différentes communes membres afin de recueillir l'avis des conseils municipaux, son intention de dissoudre le syndicat en question. Les conseils municipaux disposent d'un délai de 3 mois pour délibérer, à défaut leur avis est réputé favorable
La dissolution est prononcée après accord de la majorité qualifiée des communes membres: il s'agit d'une majorité qualifiée assouplie constituée par la moitié des communes représentant au moins la moitié de la population totale dont la commune la plus importante si elle représente le tiers de la population totale.
A défaut d'accord de la majorité qualifiée des communes membres, le Préfet peut, jusqu'au 1er juin 2013, poursuivre la procédure et, par une décision motivée prise après avis conforme de la CDCI, prononcer unilatéralement la dissolution du syndicat.
La dissolution suit ensuite les règles de droit commun examinées ci-dessous.
Les étapes de la dissolution
Il convient d'indiquer que la procédure de dissolution applicable à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a été remaniée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
Désormais, l'article L.5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux étapes pour aboutir à cette dissolution:
Un premier acte (arrêté préfectoral ou décret du 1er ministre s'il s'agit d'une dissolution d'office), met fin à l'activité du syndicat de communes dont les biens et les droits doivent alors être partagés entre les communes membres comme le prévoit l'article L.5211-25-1 (cf. infra.). A noter que ce premier acte peut prononcer la dissolution de l'EPCI, s'il n'existe aucun obstacle à sa liquidation (notamment en ce qui concerne la réalisation du partage des biens et l'adoption du compte administratif).
A défaut, le Préfet sursoit à la dissolution. Celle-ci est prononcée dans un second acte. Le syndicat de communes conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le Président rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation au Préfet. Pendant le déroulement de ces opérations de liquidation, les dispositions financières et comptables régissant l'activité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles L.1612-1 à L.1612-20 du CGCT) restent applicables aux budgets et comptes administratifs du syndicat dont la dissolution est prévue. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le Préfet arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes. Le Préfet nomme également un liquidateur chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. L'intervention du liquidateur ne peut dépasser une durée d'un an, prolongeable une seule fois. Après l'arrêt des comptes par le Préfet, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le respect des dispositions de l'article L.5211-25-1. Enfin, la dissolution du syndicat de communes est prononcée par arrêté préfectoral qui constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif.
Les conséquences de la dissolution
En ce qui concerne les biens et les contrats, les règles applicables sont identiques à celles applicables en cas de retrait d'une compétence transférée ou, plus généralement, de retrait d'une commune.
En effet, l'article L.5211-25-1 du CGCT, auquel renvoie l'article L.5211-26 du même code, prévoit :
- la restitution aux communes des biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'EPCI lors du transfert de compétence, avec les adjonctions effectuées sur ces biens. Ces biens sont réintégrés dans le patrimoine communal pour leur valeur comptable nette. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué. La commune reprend les biens avec les droits et obligations qui s'y rattachent ;
- le partage des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences entre le groupement et la commune qui se retire. Cette répartition s'applique également au solde de l'encours de la dette contractée par l'EPCI.
La loi laisse donc aux communes et au groupement la liberté de trouver un terrain d'entente.
On notera seulement que la jurisprudence impose de prévoir des modalités de répartition et de compensation équitables pour les communes membres (CAA de Nancy, 2 juin 2008, n°07NC00596).
C'est également ce que rappelle la fiche du “Guide pratique de l'intercommunalité”, relative au retrait (mais le raisonnement est identique en cas de dissolution) en indiquant que :
"Hormis le principe général d'équité, ni la loi ni la doctrine administrative ne fixent de critères de répartition. Dès lors qu'aucune disposition normative n'encadre expressément les modalités de répartition, il appartient aux parties concernées de déterminer la clé de répartition au vu d'éléments objectifs qui dépendent des circonstances de fait (implantation des biens, ancienneté des investissements, contributions des membres de l'EPCI...). En vertu du principe de spécialité territoriale, il paraît logique de retenir que les biens immeubles, ne pouvant pas être scindés ainsi que le solde de l'encours de la dette y afférente, soient transférés à la commune d'implantation" (article 2.2.3 de la Fiche 331 du Guide pratique de l'intercommunalité).
Deux scénarios peuvent ainsi être envisagés:
Une répartition des biens fondée sur la localisation géographique: le bien reste acquis à la commune ou au groupement dès lors qu'il est situé sur son territoire.
Une répartition fondée sur la localisation géographique des biens qui intègre l'idée d'un dédommagement des communes pénalisées par la première hypothèse, selon le principe d'équité.
Enfin, les communes membres sont substituées au syndicat de communes pour la poursuite des contrats conclus par ce dernier. Ceux-ci sont exécutés jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. Le syndicat de communes informe les cocontractants de cette substitution.
Le transfert automatique des contrats constitue une garantie, à laquelle les communes membres peuvent toutefois renoncer si elles le jugent utile à plus long terme. Dans ce cas, des indemnités de résiliation sont dues au cocontractant. Elles sont réparties entre toutes les communes.
Le sort du personnel du syndicat dissout est organisé par l'alinéa 4 de l'article L.5214-28 qui précise que:
“La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes".
La dissolution de la structure intercommunale entraine la donc répartition du personnel entre les communes membres après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau en tenant compte de leurs droits acquis.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.