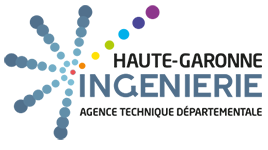Comment définir l’intérêt communautaire ?
Bien que la loi NOTRe ait considérablement restreint le champ d’application de l’intérêt communautaire, celui-ci demeure toujours d’actualité pour un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles des EPCI à fiscalité propre (les syndicats ne sont pas concernés). Si les modalités d’identification sont relativement ouvertes, l’absence de définition dans un certain délai entraînera des conséquences importantes en termes de compétences.
La notion d’intérêt communautaire
L’exercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur intérêt communautaire. Ce dernier permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention de l’EPCI à fiscalité propre.
Il s’analyse comme la ligne de partage entre les missions confiées à l’EPCI et celles conservées par les communes membres au sein d’une même compétence.
Il permet ainsi, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau communal les compétences considérées de proximité et de transférer à l’EPCI les missions qui, par leur coût, leur technicité ou leur ampleur, s’inscrivent dans une logique intercommunale. En d’autres termes et pour une même compétence, une action qui répondra à la définition de l’intérêt communautaire relèvera de la communauté, tandis que les autres continueront à relever de la compétence des communes.
Le champ d’application de l’intérêt communautaire
En vue de favoriser une intégration plus poussée des communautés de communes, la loi NOTRe a limité les compétences concernées par la définition de l’intérêt communautaire (article L.5214-16 du CGCT).
Ainsi, les compétences obligatoires ne font plus références aux actions d’intérêt communautaire sauf mention expresse (tel que l’aménagement de l’espace pour la conduite d’action d’intérêt communautaire). Il en résulte notamment que toutes les zones d’activités (existantes et à créer) ainsi que l’ensemble des actions de développement économique (notamment en ce qui concerne l’immobilier d’entreprises) ont vocation à relever désormais des communautés.
En revanche, toutes les compétences optionnelles des communautés de communes sont présentées comme étant soumises à la définition d’un intérêt communautaire : en effet, la loi dispose de façon générale que ces compétences sont exercées « pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ». Même si cela n’apparaît pas dans le libellé de chaque compétence, le conseil communautaire doit donc définir cet intérêt pour chacune des compétences de ces blocs, notamment en matière de « voirie », « politique du logement et du cadre de vie » ou de « protection et mise en valeur de l’environnement ». Il est en revanche admis que les compétences optionnelles « assainissement » et « eau » constituent désormais des blocs insécables de compétences qui ne sont donc pas soumis à la définition de l’intérêt communautaire.
En ce qui concerne les communautés d’agglomération, il convient de se référer au libellé de chaque compétence pour déterminer si celle-ci est soumise à la définition d’un intérêt communautaire (article L.5216-5 du CGCT).
Enfin, il convient de noter que les compétences supplémentaires (c’est-à-dire celles qui ne sont ni obligatoires, ni optionnelles) ne sont pas soumises à la définition de l’intérêt communautaire.
Les modalités de définition de l’intérêt communautaire
La loi n’a fixé aucune méthode particulière permettant de procéder à la définition de l’intérêt communautaire.
Sont toutefois à proscrire les formulations générales, évasives ou imprécises afin de garantir la sécurité juridique des interventions des EPCI et de leurs communes membres. Il convient ainsi d’éviter les exemples de formulations suivantes : la référence au « caractère stratégique pour le développement de l’espace communautaire » ou le recours à l’adverbe « notamment » ou encore aux points de suspension.
De même l’intérêt communautaire ne doit pas être fondé sur la distinction entre l’investissement et le fonctionnement.
De manière générale, la doctrine ministérielle (cf. « Guide pratique de l’intercommunalité ») recommande d’avoir recours à des critères objectifs permettant de circonscrire l’intérêt communautaire.
Ces critères peuvent être de nature financière (seuils), reposer sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou de logements, etc.) ou encore quantitatifs (fréquentation d’une infrastructure en nombre de véhicules ou d’un équipement en nombre d’entrées par mois ou par semaine, etc.).
A défaut de critères objectifs pertinents, il reste toutefois possible de procéder par liste : dans cette hypothèse, toute nouvelle intervention de l’EPCI nécessitera alors de procéder à une modification de l’intérêt communautaire.
Pour des exemples de définition de l’intérêt communautaire : (cf. FT n°14 : Modèle de délibération).
Par ailleurs, dans le cas d’EPCI fusionnés, le ministère de l’intérieur considère que l’intérêt communautaire permet, sous réserve de critères objectifs, au nouvel EPCI de n’exercer la compétence en question que pour une partie du territoire correspondant au périmètre de l’EPCI fusionné qui exerçait effectivement la compétence (par exemple pour les équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire).
Les conditions de forme et de délai relatives à la définition de l’intérêt communautaire
Pour les communautés existantes, la définition de l’intérêt communautaire doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert. A défaut, la communauté ou la métropole exerce l’intégralité de la compétence concernée. Dans l’attente de cette définition et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de deux ans, les communes restent compétentes alors même que la compétence est inscrite dans les statuts de l’EPCI.
Pour les communautés issues d’une fusion, l’intérêt communautaire est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, le nouvel EPCI exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des EPCI ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.
A noter qu’en dépit d’une nouvelle rédaction induite par l’article 81 de la loi NOTRe, l’intérêt communautaire reste défini par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des membres du conseil et non des suffrages exprimés (Réponse ministérielle à la question n° 19598, JO Sénat, 7 juillet 2016 p. 3022).
En outre, les communes n’ont pas à valider la rédaction de cette définition.
Enfin, la définition de l’intérêt communautaire peut être modifiée à tout moment au cours de la vie de l’EPCI. Une définition initiale ne s’oppose pas à son évolution ultérieure.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.