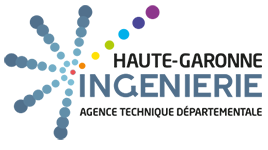La création d’une commune nouvelle
Au cours des deux dernières années, 547 communes nouvelles (regroupant 1 800 communes « historiques ») ont été créées, alors que ce chiffre était d’à peine 25 entre 2011 et 2014. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce succès (incitations financières, volonté de se regrouper pour pouvoir peser au sein des nouvelles intercommunalités élargies, coopération existant déjà entre communes, …). Compte tenu de l’évolution des périmètres et dans la mesure où le législateur a prévu de maintenir les incitations financières, tout porte à croire que ce mouvement va continuer.
La présente fiche a donc pour objet de préciser les modalités juridiques ainsi que les conséquences financières de la création d’une commune nouvelle. Elle aborde également les conséquences d’une telle création en matière informatique.
Aspects juridiques de la commune nouvelle
Caractéristiques générales
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit un dispositif renouvelé pour la fusion de communes, en remplacement de celui de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971.
Désormais, la fusion de communes entraîne la création d’une commune nouvelle. La commune nouvelle est une nouvelle commune : elle a seule la qualité de collectivité territoriale (article L.2113-10 dernier alinéa du code général des collectivités territoriales -CGCT-). C’est donc une commune à part entière qui dispose :
- de la clause générale de compétence,
- d’un conseil municipal,
- d’un maire et d’adjoints,
- de la fiscalité communale.
La commune nouvelle, créée en lieu et place des anciennes communes, se voit donc notamment transférer, après réalisation d’un inventaire, leur patrimoine, personnel et dette.
Pour autant, et sauf délibération contraire des conseils municipaux lors de la création1 les anciennes communes subsistent dans leurs nom et limites territoriales sous forme de communes déléguées avec un maire délégué et une mairie annexe (pour l’état civil). Il est également possible pour le conseil municipal de la commune nouvelle (à la majorité des 2/3) de créer un conseil de la commune déléguée (dont les membres sont désignés par le conseil municipal) : les communes déléguées fonctionnent comme les arrondissements à Paris, Lyon et Marseille.
A noter que le législateur n’a pas prévu de procédure de « défusion » pour les communes nouvelles. Une éventuelle « défusion » serait donc régie par la procédure de droit commun portant modification des limites territoriales communales telle que prévue par les articles L.2112-2 et suivants du CGCT.
Les modalités de création d’une commune nouvelle
Une commune nouvelle ne peut être constituée que par des communes contiguës. Le projet peut-être initié :
• soit par tous les conseils municipaux des communes concernées (la délibération est prise à la majorité absolue des suffrages exprimés);
• soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
• soit par le conseil communautaire, à condition que la totalité de son périmètre soit concernée ;
• soit par le préfet.
En cas d’initiative du conseil communautaire ou du préfet, le projet de création ne peut aboutir que si les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci y sont favorables. Dans les autres hypothèses d’initiative, le projet et les délibérations correspondantes sont directement transmises au préfet. Les délibérations qui sollicitent la création d’une commune nouvelle doivent indiquer :
- le nom des communes fondatrices et la population totale regroupée,
- le nom de la commune nouvelle,
- le chef-lieu de la commune nouvelle,
- la date de création souhaitée,
- la composition du conseil municipal de la commune nouvelle, si les communes souhaitent que pendant la période transitoire le conseil municipal comprenne l’ensemble des anciens membres des conseils municipaux des communes.
- l’EPCI de rattachement de la commune nouvelle lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts.
Ces délibérations peuvent également indiquer, si les communes le souhaitent :
- la mise en place d’un système d’intégration progressif,
- le refus de l’instauration de communes délégués.
De manière générale, les membres du conseil municipal doivent être informés de façon exacte et complète sur les conséquences de la création d’une commune nouvelle (TA Rouen, 18 juin 2013, association Bihorel avec vous, n° 1100244) et notamment, sur le coût, sur les conséquences en matière d’imposition locale et sur la composition temporaire du conseil municipal de la commune nouvelle. Il est également important de souligner que les délibérations des communes doivent être précédées de la consultation préalable des comités techniques sur le fondement de l’article 33 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Aucune consultation électorale n’est requise, si tous les conseils municipaux des communes concernées sont favorables à la création d’une commune nouvelle. En revanche, en l’absence d’unanimité des conseils municipaux, et à condition que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci se soient prononcés favorablement, une consultation électorale doit être obligatoirement organisée. Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales de chaque commune concernée sont alors consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. La création ne peut alors être décidée par le préfet qu’à la double condition que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille dans chacune des communes concernées l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Enfin, il est important de relever qu’aucune commune nouvelle ne devrait pouvoir être créée au 1er janvier 2020. En effet, en vertu de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, "Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées". Dans une réponse adressée à l’AMF, la Direction générale des collectivités locales en déduit qu’un an avant les élections municipales, les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées et en conclut donc que la création de communes nouvelles au 1er janvier 2020 ne sera juridiquement pas possible. Cet élément doit donc être pris en compte dans la réflexion, même si un report des élections municipales en 2021 n’est pas exclu.
Les conséquences de la création d’une commune nouvelle
Le nom de la commune nouvelle
Le nom de la commune nouvelle est fixé par accord des communes lorsqu’elles délibèrent sur sa création, sinon celui-ci est proposé par le Préfet (article L.2113-6 du CGCT).
Conséquences sur les biens, droits, obligations et EPCI
La commune nouvelle est substituée aux communes pour toutes les délibérations et les actes et pour l’ensemble des biens, droits et obligations. Tous les personnels municipaux sont également rattachés à la commune nouvelle (article L.2113-5 du CGCT).
Si la commune nouvelle est située à cheval sur le territoire de deux EPCI à fiscalité propre, une procédure spécifique devra être engagée sur ce point pour décider de l’EPCI de rattachement (cf. article L.2113-5 du CGCT). Celle-ci a été revue en octobre 2016 suite à la censure du Conseil constitutionnel2. Cet article prévoit désormais une procédure permettant de recueillir l’avis de l’ensemble des communes, EPCI et communes membres de ces derniers ainsi que la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) en cas de désaccord.
Le nombre de sièges attribué à la commune nouvelle au sein de l’EPCI à fiscalité propre est au moins égal au nombre total de sièges attribués aux anciennes communes (article L.5211-6-2 1° bis du CGCT), mais il n’y a aucune obligation de respecter la répartition des sièges selon les anciennes communes d’origine (CE, 18 octobre 2017, n° 410193).
La composition du conseil municipal
Après la création de la commune nouvelle et jusqu'aux prochaines élections municipales, l'assemblée délibérante de la nouvelle collectivité est constituée :
- soit de l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;
- soit, et à défaut, des maires, des adjoints et de conseillers municipaux des anciennes communes, en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
L'effectif total du conseil ne peut dépasser 69 membres, sauf si la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires (art. L.2113-7).
Lors du premier renouvellement du conseil (soit 2020), la strate démographique à prendre en compte pour déterminer le nombre de conseillers sera celle immédiatement supérieure à celle de la commune nouvelle (cf. tableau article L.2121-2 du CGCT).
En revanche, le montant cumulé des indemnités des conseillers municipaux de la commune nouvelle ne pourra excéder le montant total des indemnités auxquelles auraient eu droit les membres du conseil municipal d'une commune de même strate démographique (art. L.2113-8).
La création de communes déléguées
Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes sont instituées, sauf lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux en vue de la création de la commune nouvelle ont exclu leur création.
Par la suite, le conseil municipal de la commune nouvelle (qui a seule la qualité de collectivité territoriale et donc une personnalité juridique) peut néanmoins décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine (art. L.2113-10).
La création de communes déléguées entraîne de plein droit, pour chacune d'entre elles, l'institution d'un maire délégué et la mise en place d'une annexe de la mairie pour l'établissement des actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée (art. L.2113-11). Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle, parmi ses membres. Mais, par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal (art. L.2113-12-2).
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire et peut recevoir des délégations du maire de la commune nouvelle, tout en exerçant également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle (art. L.2113-13).
En outre, le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des 2/3 de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées, d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres (art. L.2113-12 et L.2113-12-2).
Le conseil municipal de la commune nouvelle peut aussi désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué, dans la limite de 30 % du nombre total des conseillers communaux (art. L.2113-14). Selon la doctrine ministérielle, seules les fonctions de maires délégués et d’adjoints au maire délégué ouvrent droit à indemnités de fonction3. Ainsi, il ne serait pas possible d’attribuer des indemnités de fonction aux conseillers communaux. En revanche, des indemnités de fonction sont possibles au profit des conseillers municipaux de la commune nouvelle titulaires de délégation.
En matière de gestion financière, l’article L.2113-17 du CGCT prévoit l’application aux communes déléguées des dispositions prévues pour les mairies d’arrondissement.
Aspects financiers de la commune nouvelle
Les dotations de l’Etat
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
Comme pour les communes, la dotation globale de fonctionnement des communes nouvelles est composée d’une dotation forfaitaire et de dotations d’aménagement.
L’année de sa création, la dotation forfaitaire (DF) est égale à la somme des dotations forfaitaires communales versées l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant.
La commune nouvelle peut être éligible au prélèvement sous condition de potentiel fiscal, destiné à financer les réallocations internes de DGF en faveur de l’accroissement de la péréquation (III de l'article L.2334-7 du CGCT). L’année de création de la commune nouvelle, le calcul du potentiel fiscal s’appuie sur les bases des anciennes communes (article L.2113-21 du CGCT).
La loi de finances pour 2018 a prorogé la majoration de DF pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création interviendra entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Il s’agit d’une majoration de 5 % durant les trois premières années (article L.2113-20 du CGCT).
Enfin, l’article L.2113-22 du CGCT dispose que les communes nouvelles sont éligibles aux dotations d’aménagement (DSR et DNP) dans les conditions de droit commun.
Le calcul de ces dotations s’appuie sur des indicateurs redéfinis au niveau de la commune nouvelle. Ainsi, le potentiel financier correspond à la somme du potentiel fiscal et de la dotation forfaitaire des anciennes communes, hors part compensation suppression part salaire de la taxe professionnelle 2014 (CPS) des anciennes communes, sur l’évolution du taux de la dotation forfaitaire. Les éléments à prendre en compte correspondent aux données de l'année précédant la perception du premier produit fiscal de la commune nouvelle.
L’article 159 de la loi de finances pour 2018 précitée, maintient également le mécanisme de garantie des dotations d’aménagement prévu à l’article L.2113-22 du CGCT, pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création sera pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Elles seront assurées de percevoir, durant les trois premières années des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation (DNP), de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale (DSR) au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
Les autres dotations
La commune nouvelle bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de Fonds de Compensations de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui lui permet de percevoir le FCTVA relatif aux dépenses réelles d’investissement réalisées au cours de l’exercice.
Elle est également éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) pendant les trois années suivant sa création si au moins une des communes préexistante y était éligible l'année précédant le regroupement (article L.2334-33 du CGCT).
Les conséquences fiscales de la création d’une commune nouvelle
La commune nouvelle perçoit une fiscalité communale.
Le processus d’harmonisation fiscale
L’intégration fiscale des anciennes communes est facilitée par le dispositif d’harmonisation prévu à l’article 1638 du Code Général des Impôts (CGI).
Les taux d’imposition des trois taxes directes locales perçues par les anciennes communes (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti) peuvent être harmonisés. Il revient soit à la commune nouvelle soit, par anticipation, aux anciennes communes de délibérer pour instituer cette procédure d'intégration fiscale progressive et en déterminer la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la nouvelle entité. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année à parts égales.
A noter que cette procédure d'intégration fiscale progressive peut être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation.
La détermination des taux d’imposition
Quelle que soit la date de création, il reviendra au conseil municipal de la commune nouvelle de déterminer et voter les taux d’imposition l’année suivant sa création.
Toutefois, le III de l’article 1638 du CGI précise que l'arrêté de création d’une commune nouvelle ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante, que s’il intervient avant le 1er octobre de l'année.
Ainsi, lorsqu’elle est créée avant le 1er octobre d’une année, la commune nouvelle fixe pour l’année suivante les taux d’imposition unique pour chaque taxe. Ce taux est déterminé à partir du calcul des taux moyens pondérés par leurs bases de l’année précédente (rapport entre la somme des produits nets de chaque taxe perçue par les communes regroupées et la somme des bases nettes de ces communes).
Si l’écart de taux le permet, l’intégration fiscale détaillée ci-dessus peut commencer cette année-là.
En revanche, si l’arrêté de création est postérieur au 1er octobre d’une année, cette procédure ne sera réalisée qu’à compter de la deuxième année.
Dans ce cas, la première année, la commune nouvelle vote, en lieu et place des communes préexistantes, les taux applicables sur leur territoire. Pour chaque taxe, il peut donc exister autant de taux différents que de communes participant à la fusion. Les rôles d’impôts directs locaux sont émis au nom de chacune des communes préexistantes.
Les délibérations fiscales
Les délibérations fiscales doivent être prises par la commune nouvelle ou par les communes préexistantes l'année précédant la création, par délibérations concordantes, selon les dates limites fixées pour chaque taxe.
A défaut, la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit généralement l’application des délibérations adoptées antérieurement par les communes pour leur durée et leur quotité lorsqu’il s’agit de dispositifs limités ou pour un an pour les autres mesures.
Des dispositions spécifiques concernant la taxe d’aménagement ont également été introduites afin que les délibérations des anciennes communes renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant ne puissent pas s’appliquer au-delà de la première année d’existence de la commune nouvelle.
Comme pour la méthode de fixation des taux d’imposition, si l’arrêté de création intervient après le 1er octobre d’une année, il ne produit aucun effet fiscal la première année. Les délibérations votées par les communes «historiques» continuent alors de s’appliquer sur cet exercice.
Les conséquences de la création d’une commune nouvelle sur les outils informatiques
La création d’une commune nouvelle va conduire à la mise en place d’un système informatique commun.
En effet, dans une visée opérationnelle, parmi les logiciels applicatifs de gestion financière, de ressources humaines, d’état civil, des élections, SIG, des droits des sols, de facturation, ainsi que les sites Internet présents dans les communes, il conviendra de déterminer ceux qui seront conservés et d’anticiper l’unification des bases de données.
Dans ce cadre, d’un point de vue méthodologique, la commune nouvelle devra établir un état des lieux des logiciels, du matériel et des bases de chaque commune, puis définir les besoins de la commune nouvelle.
L’état des lieux doit permettre de mesurer, fonctionnellement, si les outils informatiques présents permettent a minima de :
- clôturer les exercices des anciennes communes,
- interroger les exercices précédents,
- traiter les écritures particulières de fin d'exercice (rattachement, ICNE...),
- reprendre/gérer l’actif (immobilisation) et le passif (emprunt),
- fonctionner avec les données fusionnées en paie et en comptabilité,
- élaborer le budget prévisionnel,
- gérer les payes,
- traiter la fusion des listes électorales, les modalités de refonte et les éditions,
- rédiger les actes d’état-civil.
Cette analyse doit être étendue aux outils bureautiques ou collaboratifs (messagerie notamment), aux logiciels ou aux macros développés en interne (par exemple, EXCEL, ACCESS, SQL...).
Techniquement, l’état des lieux doit démontrer que le système informatique peut :
- proposer une localisation des données (anciennes et nouvelles) permettant aux utilisateurs d'en disposer (sur les postes existants, sur des nouveaux postes, dans un espace de stockage ou sur le « Cloud ») ;
- supporter les outils répondant à l’ensemble des pré-requis fonctionnels imposés par les éditeurs ;
- assurer la garantie et le respect des échanges (anciens et nouveaux) avec les partenaires institutionnels ;
- tolérer le fonctionnement des outils de la RH (paie mensuelle et DSN) et de la gestion financière (opérations courantes) ;
- assurer le transfert éventuel des signatures électroniques ;
- répondre à la mise en réseau des différents sites administratifs et techniques de la commune nouvelle.
-------------------------------------------------
1Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également décider de les supprimer dans un délai qu’il détermine.
2Pour une analyse de cette décision voir infolettre n°182
3 Cf. FAQ sur la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.