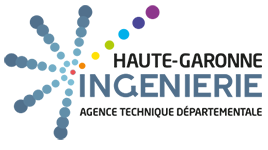Comment démissionner ?
La démission d'un élu local, qu'elle soit volontaire ou forcée, constitue un événement souvent difficile, qui doit être géré sans impair juridique.
Voici donc un aperçu du droit applicable aux démissions volontaires et d'office des élus locaux (s'agissant des présidents et vice-présidents d'EPCI, les règles applicables en la matière sont les mêmes que celles respectivement applicables aux maires et aux adjoints).
La démission volontaire
Quand et comment présenter la démission ?
Un élu peut démissionner à tout moment de son mandat.
Il doit alors le faire en termes clairs par lettre écrite, datée et signée ; ainsi, annoncer publiquement son intention de démissionner n'équivaut pas à une démission.
Cette lettre doit être adressée, en recommandé ou non :
- au maire pour les conseillers municipaux à charge pour lui d'en transmettre copie au préfet (article L.2121-4) ;
- au préfet pour les maires et adjoints (article L.2122-15) : sur ce point, il convient de préciser qu'un maire ou un adjoint a le choix entre deux types de démissions : il peut décider de se démettre soit de son mandat de maire (ou d'adjoint) tout en demeurant conseiller municipal, soit de démissionner en même temps de son mandat de conseiller municipal.
Il n'est pas réellement obligatoire pour l'autorité qui reçoit la démission d'en accuser réception ; toutefois, cette formalité s'avère, en raison de la suite de la procédure, pratiquement obligatoire.
Les démissions collectives par lettre unique sont possibles à la condition que la volonté de chacun de démissionner soit clairement identifiable (noms, signatures correspondantes, …).
Par ailleurs, il est possible de fixer une date postérieure d'entrée en vigueur de la démission.
La démission peut-elle être refusée ?
Le refus d'une démission n'est possible qu'à titre temporaire pour le maire et l’adjoint. En effet, le préfet peut refuser cette démission, ou encore ne pas répondre à celle-ci.
Dans ce cas, l'élu doit renouveler sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception (après un délai raisonnable). Sa démission sera alors définitive un mois après cette seconde lettre ou même plus tôt si le préfet « accepte » enfin la démission (article L.2122-15). Faute de ce nouvel envoi, l'élu reste en charge de tous ses mandats.
S'agissant d'un conseiller municipal, le maire ne peut refuser sa démission et doit la transmettre au préfet.
L’élu peut-il retirer sa démission ?
Le retrait de démission par le démissionnaire est :
- possible pour le maire et les adjoints tant que le préfet n'a pas accepté cette démission, mais une fois cette acceptation formulée, même si le maire continue d'exercer ses fonctions à titre temporaire, celui-ci ne peut plus retirer sa démission.
- impossible pour le conseiller municipal, sauf accord amiable tant qu'aucune trace officielle de la démission ne subsiste.
Quels sont les conséquences de la démission d’un élu ?
Les conséquences de la démission du maire :
Application du régime de la suppléance :
Selon l'article L.2122-15, « le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ».
Le maire démissionnaire, dès que sa démission est effective, se trouve en situation d'empêchement (Rép. Min. n° 21764, JO AN du 6 octobre 2003).
Le régime de la suppléance dans les conditions prévues par l'article L.2122-17 s'applique donc : les fonctions de maire sont exercées par un adjoint (dans l'ordre des nominations) ou par un conseiller municipal (désigné par le conseil municipal, ou à défaut pris dans l'ordre du tableau).
Election d’un nouveau maire :
La convocation du conseil municipal pour l’élection du nouveau maire est adressée par le premier adjoint (article L.2122-17).
Le maire démissionnaire est convoqué lorsqu’il a simplement démissionné de son mandat de maire, et non de celui de conseiller municipal. La présidence de la séance du conseil municipal est assurée par le doyen d’âge, qui peut d’ailleurs être le maire démissionnaire (CE, 25 mai 1973, n° 88323).
Lorsque le maire a également démissionné de son mandat de conseiller municipal, il y a lieu de compléter le conseil municipal, de le convoquer pour élire le nouveau maire. Selon l’article L.2122-8, le conseil municipal doit en effet être au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. L’expression « au complet » ne signifie pas que tous les conseillers municipaux élus doivent être présents lors de l’élection de la municipalité, mais que le conseil municipal doit avoir été élu dans son intégralité, c'est-à-dire qu’il doit y avoir autant de conseillers élus que de sièges à pourvoir (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Néanmoins, pour que l’élection soit valable, le quorum doit être atteint.
Enfin, quand, pour quelque cause que ce soit, il y a une nouvelle élection du maire, on procède à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs (article L.2122-10).
Précisons que le conseil municipal n’a pas l’obligation de pourvoir tous les postes d’adjoint créés. Il peut ainsi décider après une démission, de ne pas procéder au remplacement d’un adjoint (TA Amiens 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d’Amiens).
Les conséquences de la démission du président de l’EPCI
Le premier vice-président assure la suppléance du président (article L.2122-7). Il convoque le conseil communautaire dans la quinzaine afin d’élire le nouveau président (article L.2122-14).
Les conséquences de la démission d’un adjoint :
En cas de démission d'un adjoint, le conseil municipal est convoqué à compter de la prise d'effet de la démission, c'est-à-dire à compter du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance du démissionnaire, afin de combler la vacance et d'élire un nouvel adjoint (cf. infra).
Election d’un nouvel adjoint :
Une fois la démission entérinée par le préfet, le poste d’adjoint est alors vacant. Le conseil municipal est convoqué dans la quinzaine pour procéder à ce remplacement (article L.2122-14). Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une élection complémentaire si l’adjoint a également démissionné de son mandat de conseiller municipal puisque, selon l’article L.2122-8, pour toute élection du maire et des adjoints, le conseil municipal doit être au complet (voir supra).
Toutefois, ce même article prévoit une exception : « quand il y a lieu à l’élection d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal » ou comporte moins de cinq membres.
Pour remplacer l’adjoint démissionnaire, deux situations peuvent se présenter :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants
- Le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera le même rang que l’adjoint qu’il est amené à remplacer (article L.2127-7-1).
- Si le conseil décide ne pas élire l’adjoint au même rang que l’adjoint qu’il remplace, alors chacun des adjoints remontera d’un cran dans l’ordre du tableau.
Ainsi, l’ordre du tableau des adjoints ne peut pas être modifié à l’occasion du vote élisant un nouvel adjoint. Ce dernier prend donc rang après tous les autres (CE, 3 juin 2005, n° 271224).
Dans les communes de 1 000 habitants et plus
En cas de vacance, l’adjoint ou les adjoints à désigner, sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants (article L2122-7-2). Ainsi, si le 1er adjoint est un homme, en cas de démission il devra être remplacé par un homme obligatoirement. Le conseil municipal décidera en amont si ce dernier occupera automatiquement la place de 1er adjoint. Dans le cas contraire, il occupera la dernière place parmi les adjoints et chaque adjoint remontera d’un rang dans l’ordre du tableau.
Les conséquences de la démission d’un vice-président
Aux termes de l’article L.5211-10, le conseil communautaire est compétent pour fixer le nombre de vice-présidents. Aussi il doit être saisi lorsqu’un vice-président a démissionné, soit pour le remplacer, soit pour réduire le nombre de vice-présidents.
Les conséquences de la démission d’un conseiller municipal
La démission d'un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le maire.
Si l'ensemble du conseil municipal démissionne, le préfet institue une délégation spéciale en attendant de nouvelles élections municipales dans la commune.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants
Les conseillers municipaux démissionnaires ne sont pas remplacés.
Toutefois, une élection complémentaire doit être organisée afin de pourvoir à la vacance si le conseil municipal a perdu un tiers ou plus de son effectif ou s’il compte moins de 5 membres (ce seuil est porté à la moitié l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux - article L.258 du code électoral, ou si le conseil municipal compte moins de 4 membres.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus
Le conseiller municipal démissionnaire est remplacé automatiquement par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu (article L.270 du code électoral ; CE, 16 janvier 1998, n°188892) dans les conditions suivantes :
- il est tenu compte de l’ordre de la liste déposée à la préfecture et non de l’ordre de la liste figurant sur les bulletins de vote (CE, 6 mai 1985, Elections municipales de Moreuil),
- la parité n’est pas applicable, notamment si le candidat remplaçant ne souhaite pas exercer le mandat municipal,
- le maire dresse un procès-verbal d’installation du conseiller municipal qui a accepté de pourvoir la vacance du siège, afin de proclamer son élection et procède à l’affichage de ce procès-verbal afin de faire courir les délais de recours contre cette élection (articles L.248 et R.119 du code électoral ; circulaire n°INT/A/06/00075/C du 9 août 2006 relative à l’élection et au mandat des assemblées et exécutifs locaux).
- l’élu remplaçant est intégré à la fin du tableau des conseillers municipaux,
Lorsqu’il n’y a plus de suivant de liste, il est procédé au renouvellement du conseil municipal:
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, ou au moins la moitié des membres ou s’il compte moins de 4 membres dans l’année de renouvellement des conseils municipaux.
2° Dans les conditions prévues pour l’élection du maire et des adjoints, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Dans toutes les communes
Il est nécessaire de compléter le conseil municipal par des élections complémentaires lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire (article L.2122-8 CGCT).
Les conséquences sur les délégations de fonction et les indemnités de fonction :
L’arrêté de délégation de fonction est caduc dès que la démission est définitive (Rép. Min. n° 37821, JO AN du 6 mars 2000).
Le versement des indemnités de fonction est subordonné à l’exercice effectif des fonctions. Aussi, cette indemnité n’est plus systématiquement due lorsque l’élu démissionne :
- le maire qui reste conseiller municipal pourra percevoir une indemnité de fonction maximale égale à 6 % de l’indice 1027 si le conseil municipal a voté l’attribution de cette indemnité aux conseillers, ou une indemnité non plafonnée comprise dans l’enveloppe globale indemnitaire s’il reçoit une délégation,
- l’adjoint ne peut plus percevoir d’indemnités dès que la démission est définitive, s’il reste conseiller municipal, il pourra percevoir une indemnité selon les conditions précisées au point précédent pour le maire,
- le conseiller municipal ne peut plus percevoir d’indemnités dès que sa démission est définitive, car il n’a plus la qualité d’élu.
Si le conseiller n’a pas précisé dans son courrier une date de démission postérieure à celle de la réception du courrier de démission par le maire, la prise d’effet de cet acte de démission est la date de réception par le maire.
Dès lors il sera mis fin au paiement des indemnités de fonction à partir de cette date.
Pour le maire et l’adjoint, la démission produit ses effets dès l'acceptation donnée et notifiée à l'intéressé par le préfet (CE, 6 février 1974, n° 089201).
Lorsque le maire ou l’adjoint précise dans sa lettre de démission une date de prise d'effet de sa démission, ce report peut être refusé par le Préfet (CE Ass, 26 mai 1995, nos 167914 et 168932). Dans ce cas, les indemnités cesseront d’être versées à la date où le préfet a accepté la démission.
La démission d'office
La démission d'office est, en fait, une forme de « révocation » : l'élu municipal est démis de ses fonctions contre sa volonté, principalement dans deux hypothèses.
Le refus de remplir une des fonctions dévolues par les lois
Tout élu qui, « sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » (article L.2121-5).
Trois conditions, strictement entendues, sont donc posées pour qu'il y ait légalement, démission d'office :
- La « fonction dévolue par les lois » doit être explicitement prévue par une loi ou par un texte réglementaire, et cela, à titre obligatoire. Ainsi, depuis 1982, les absences successives au conseil municipal d'un adjoint ou d'un conseiller municipal ne peuvent, à elles seules, justifier une démission d'office (CE, 6 novembre 1985, n° 66842). Par contre, le refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote (CE, 21 octobre 1992, n° 138437) ou les fonctions d’assesseur de bureau de vote (TA Strasbourg, 15 avril 1998, Maizery) entraînent la démission d’office.
- Le refus de l'élu peut résulter « soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation ». Dans tous les cas, le refus de l'élu doit être clair et univoque (TA Nancy, 30 juillet 2002, n° 02966; TA Amiens, 18 juillet 2002, n° 021245).
- L’élu ne doit pas avoir évoqué une excuse valable. Le refus de devenir adjoint pour un conseiller municipal d’opposition (CAA Nantes, 4 février 1999, n° 98NT02546) ou la production d’un arrêt de travail et d’un certificat médical (CAA Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE01719) sont considérés comme des excuses valables. Par contre l’excuse fondée sur des charges de famille n’est pas valable (CE, 21 mars 2007, n° 278438).
L'autorité compétente, après avoir constaté le refus de l'élu, saisit le tribunal administratif dans un délai d'un mois (ce délai est impératif), à compter du jour où elle a eu connaissance du refus.
Le tribunal administratif a, lui aussi, un mois pour statuer.
Lorsque le tribunal prononce la démission d'un élu, le greffier en chef informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
L'élu démis d'office est inéligible pour un an.
L'inéligibilité ou l'incompatibilité postérieure à l'élection
Il y déclaration de démission d'office si un élu est placé, pour une cause survenue postérieurement à son élection, dans une situation d'incompatibilité ou d'inéligibilité (article L.230 et L.231 du code électoral).
S'agissant des cas d'inéligibilité et d'incompatibilité, cf. Fiche Technique n° 2 : « Les inéligibilités et les incompatibilités ».
La déclaration de démission d'office incombe au préfet. Mais tout électeur de la commune peut demander au préfet de la prononcer.
La décision du préfet peut faire l'objet d'une réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de sa notification.
Le tribunal juge, sauf recours devant le Conseil d'Etat, selon les règles prévues pour le contentieux des opérations électorales des articles L.249 et L.250 du code électoral.
Il appartient au Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation dirigée contre un arrêté préfectoral déclarant un conseiller municipal démissionnaire d'office de son mandat lorsque le tribunal administratif n'a pas statué sur cette réclamation dans le délai prescrit à l'article R.120 du code électoral (CE, 5 février 1990, n° 102920).
Si le tribunal prononce sa décision après ce délai (2 mois), son jugement encourt l'annulation (CE, 16 décembre 1994, n° 121071).
Le requérant déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire peut, après l'intervention de l'arrêté préfectoral, s'il le conteste devant le tribunal administratif, après dessaisissement de celui-ci devant le Conseil d'Etat, continuer à exercer ses mandats (CE, n° 121071 précité).
Toutefois, lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive, le recours contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.