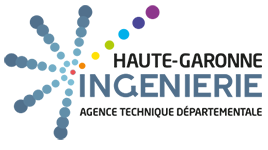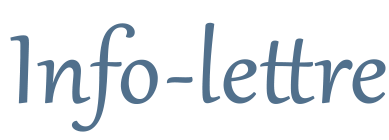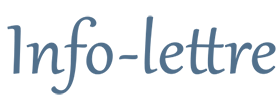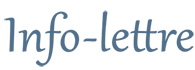L'Europe alerte sur l'état de l'environnement

Comme tous les 5 ans, fin septembre 2025, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a publié son dernier rapport sur l’état de l’environnement en Europe. Ce rapport, validé scientifiquement, fournit une évaluation complète, régulière et transversale de l’environnement, du climat et du développement durable en Europe, tout en mettant en lumière les dynamiques propres à chaque pays, dont la France.
Rapport de référence, il s’articule autour de trois volets :
- Un rapport principal de synthèse ;
- Des fiches thématiques sur 35 sujets environnementaux et climatiques, incluant les leviers de transformation verte ;
- Des profils pays, rédigés par les États eux-mêmes, qui analysent les tendances nationales en matière d’environnement, d’énergie, de mobilité et d’alimentation.
Ce rapport s’inscrit dans un contexte de fortes turbulences : crises économiques, sociales, géopolitiques et environnementales se conjuguent et accentuent les vulnérabilités. L’Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les événements climatiques extrêmes – inondations, sécheresses, incendies, vagues de chaleur – ont causé plus de 240 000 décès et généré 738 milliards d’euros de pertes économiques entre 1980 et 2023. Ces chiffres ne sont pas abstraits : ils traduisent des réalités vécues dans nos territoires, avec des impacts directs sur les populations, les infrastructures et les finances locales.
Malgré des avancées notables, notamment une réduction de 37 % des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, les progrès restent inégaux. Le rapport estime ainsi qu’environ 10 % des décès prématurés en Europe sont dus à l’exposition à l’air, à l’eau et aux sols pollués, au bruit et aux substances chimiques nocives.
De même, la biodiversité européenne décline fortement, avec plus de 80 % des habitats protégés en mauvais état et 60 à 70 % des sols dégradés.
Les ressources en eau sont également sous pression : 30 % du territoire et 34 % de la population sont concernés par le stress hydrique. L’agriculture est le principal facteur de pollution des eaux, notamment par les engrais et pesticides. Seuls 37 % des masses d’eau de surface européennes présentent un bon état écologique.
Dans le domaine énergétique, tous les États membres de l’UE ont réduit leur dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, en 2023, l’énergie reste largement dominée par ces derniers (70 % de l’énergie disponible brute), malgré une part record pour les énergies renouvelables (24 % de la consommation finale d’énergie).
Dans ce contexte européen, la France présente une situation environnementale contrastée. Elle a accompli des progrès notables, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de baisse de la pollution de l’air et de diminution de la production de déchets. En 2025, 28 % du territoire terrestre français est protégé, contre 23,9 % en 2016. La qualité des masses d’eau s’améliore également, avec près de 70 % des eaux côtières en bon état chimique.
Cependant, les pertes économiques liées aux événements climatiques extrêmes augmentent. Entre 1990 et 2023, elles ont été estimées à près de 1 475 euros par habitant, avec des pics marqués en 1999, 2003, 2022 et 2023. Les investissements liés à l’atténuation du changement climatique atteignent aujourd’hui 4 % du PIB, mais cela reste inférieur de près de 2,5 points au niveau requis pour respecter la stratégie nationale bas carbone.
Malgré une part importante d’électricité décarbonée grâce au nucléaire, la consommation finale d’énergie en France reste majoritairement dépendante des énergies fossiles, notamment dans le secteur des transports. L’empreinte carbone moyenne des Français, bien qu’en baisse depuis les années 2000, demeure élevée : 9,4 tonnes de CO₂ par habitant, contre une moyenne mondiale de 6,5 tonnes. Pour respecter les engagements climatiques, il faudrait descendre à 2 tonnes d’ici 2050. Cette empreinte n’est pas répartie équitablement : elle varie selon le niveau de revenu et le cadre de vie. En zone rurale, également, les émissions liées à l’usage de la voiture sont plus importantes, faute d’alternatives de transport public.
Ce rapport européen constitue un signal fort, mais aussi une opportunité. Il confirme que les efforts doivent être intensifiés, coordonnés et ancrés dans les réalités locales. Les collectivités locales ont un rôle central à jouer : elles sont à la fois les premières exposées aux impacts du dérèglement climatique et les mieux placées pour impulser des réponses concrètes.
L’aménagement du territoire, la planification urbaine, la gestion de l’eau, la mobilité, l’alimentation, l’énergie sont autant de leviers que les élus peuvent activer pour engager une bifurcation écologique ambitieuse, solidaire et durable.
Haute-Garonne Ingénierie est à vos côtés, pour vous accompagner dans vos choix, outiller les transitions, et faire émerger des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.